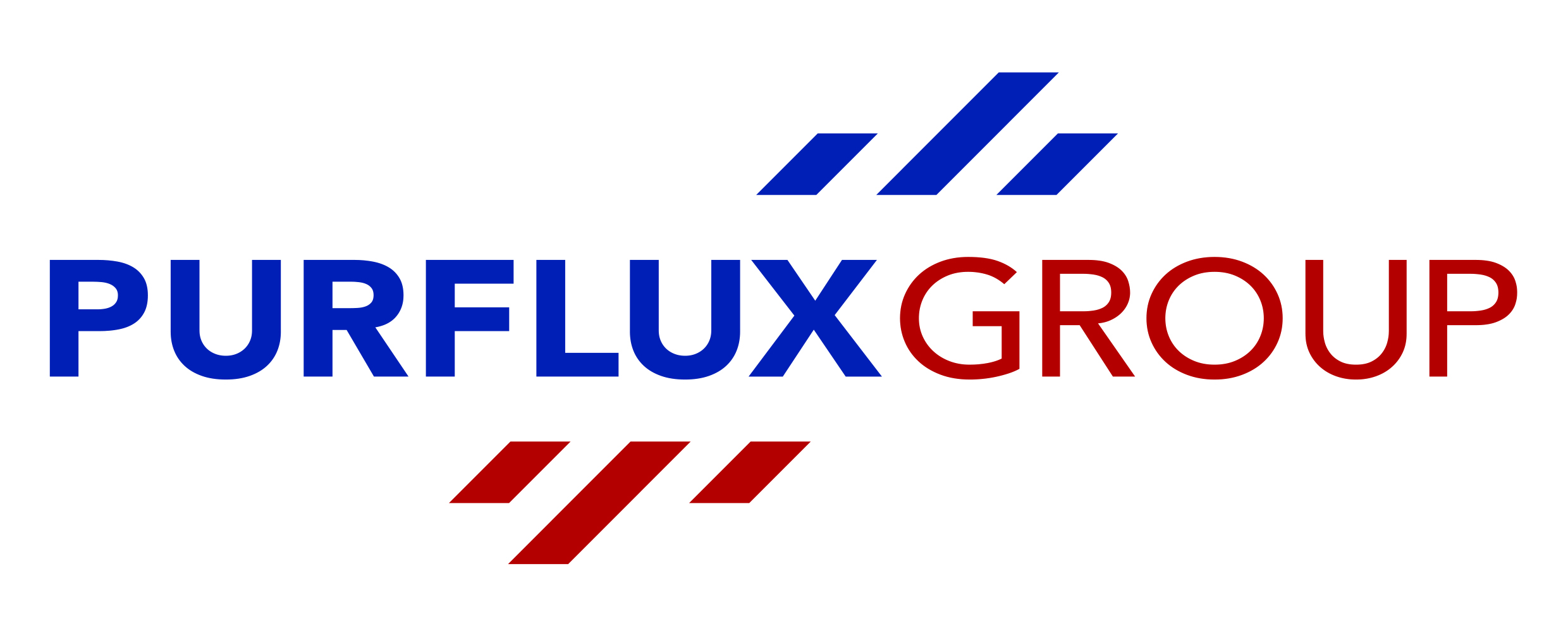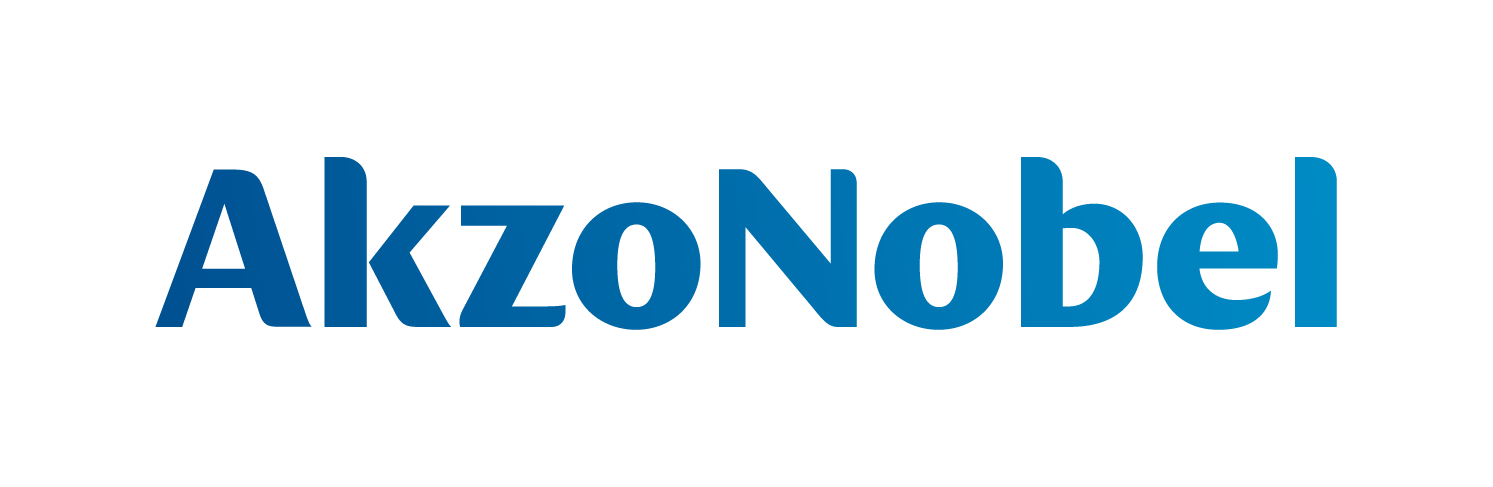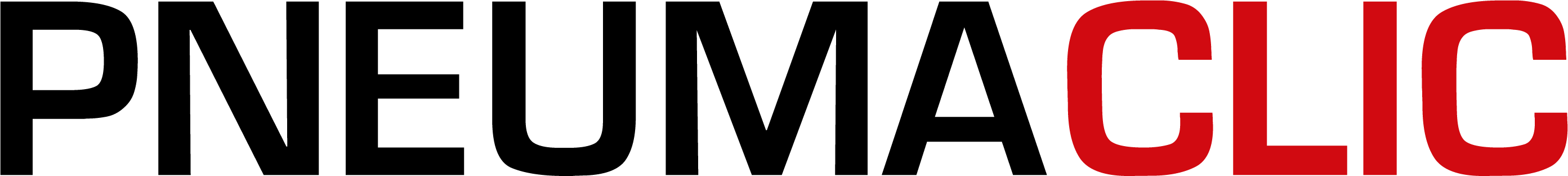En l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime matrimonial par défaut, à savoir le régime de la communauté réduites aux acquêts. En tant que chef d’entreprise, vous vous interrogez peut-être sur les incidences que ce régime légal peut avoir sur votre patrimoine.
Dans cette note, nous rappellerons les principes du régime légal de la communauté réduites aux acquêts ainsi que les risques liés aux dettes du chef d’entreprise.
Présentation du régime légal de la communauté réduites aux acquêts
Lorsqu’un chef d’entreprise est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (dit « régime de la communauté »), les biens qu’il a acquis à titre onéreux durant le mariage sont communs, c’est-à-dire qu’ils appartiennent aux deux époux. De ces biens s’ajoutent les gains et salaires ainsi que les revenus provenant de biens propres, à savoir les biens appartenant individuellement à un des époux.
De la même manière, les charges et dettes nées pendant le mariage sont supportés par les époux. Aussi, les dettes professionnelles contractées après le mariage entrent, par principe, dans la communauté. La « communauté » est le terme désignant le patrimoine commun des époux pendant le mariage.
Ainsi, le régime de la communauté produit des effets sur la composition et la gestion des biens du chef d’entreprise.
♦ Composition des biens
⇒ Les biens propres : biens appartenant uniquement à l’un des époux. Ces biens échappent à la communauté même lorsqu’ils sont acquis pendant le mariage. Dans ce cas, la communauté n’a droit qu’aux revenus générés par ces biens propres (ex : loyers, intérêts, etc.). On distingue :
- Les biens propres par nature :
- en raison de leur caractère personnel : indemnités, créances, pension incessibles, etc.
- les instruments de travail nécessaires à la profession d’un époux, sauf s’ils sont accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation dépendant de la communauté. Exemple : a été reconnue comme bien propre, la voiture acquise par un agent d’assurances pour l’exercice de sa profession (Cass.1ère Civ. 08/11/1989 n°87-12.698).
- les bien acquis avant le mariage ou acquis pendant le mariage, à titre gratuit (succession, donation ou legs).
- les biens propres par accessoire : biens qui se rattachent à d’autres biens propres par un lien matériel ou économique. Exemple : les actions acquises grâce à un droit préférentiel de souscription attaché à des actions propres.
- les biens propres par subrogation réelle : lorsqu’un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, ce dernier revêt le caractère de bien propre. Exemple : des parts sociales acquises contre l’apport d’un immeuble détenu en propre. A contrario, lorsqu’un bien est acquit au moyen de fonds propres, ce dernier entre dans la communauté, le bien est commun.
⇒ Les biens communs : biens acquis pendant le mariage à titre onéreux par les deux époux ou individuellement.
Les revenus provenant tant de l’activité professionnelle des époux (ex : salaires), que ceux produits par des biens propres ou communs (loyer, intérêts des placements, dividendes…) sont des bien communs.
⇒ Les biens mixtes : ce sont des biens comportant :
-
- un élément personnel propre à la personne de l’époux concerné (le titre)
- un élément patrimonial qui peut être commun lorsque le bien a été acquis ou créé pendant le mariage.
Exemple : les droits sociaux non négociables, tels que les parts sociales d’une entreprises sont des biens mixtes. Dans ce cas, les parts sociales acquis par un époux intègrent la communauté mais uniquement en valeur.
En revanche, la qualité d’associé demeure personnel à l’époux qui en est titulaire.
De même, en cas d’acquisition de parts sociales par un époux, son conjoint peut revendiquer la qualité d’associé. Pour plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez consulter la note relative au statut du conjoint du dirigeant.
D’autre part, lorsque les parts sociales non négociables sont acquises ou souscrites au moyen de fonds communs, l’époux est tenu d’en avertir son conjoint et ce dernier doit être justifié dans l’acte (article 1832-2 Code civil).
♦ Gestion des biens communs
Les époux disposent de pouvoirs différents sur les biens communs.
⇒ La gestion concurrente : chacun des époux peut administrer et aliéner seul les biens communs.
⇒ La gestion exclusive : lorsqu’un époux exerce une profession séparée de son conjoint, il administre seul les biens communs nécessaires à celle-ci.
Ainsi, le dirigeant peut accomplir seul les actes d’administration et de disposition nécessaires à l’exploitation de son entreprise, même si elle dépend de la communauté. L’époux qui l’exploite peut accomplir seul : le paiement de factures, souscription d’une assurance, achat et vente de matériels ou marchandises, etc.
Exception : lorsque le conjoint de l’exploitant exerce au sein de l’entreprise en tant que conjoint salarié ou collaborateur.
Dans cette hypothèse, le consentement du conjoint salarié ou collaborateur est nécessaire pour toute aliénation d’un élément du fonds de commerce ou toute mise à bail de l’un d’eux (article L. 121-5 C.com).
⇒ La co-gestion pour les actes grave : certains actes portant sur des biens communs nécessitent le consentement des deux époux, à peine de nullité (annulation de l’acte). Les actes concernés sont régis par les articles 1422 à 1425 du Code civil.
Exemple : le fonds de commerce et les exploitations dépendant de la communauté ne peuvent être vendus sans l’accord des deux époux.
Les risques liés aux dettes professionnelles
En principe, lorsqu’une dette nait pendant le mariage, son paiement peut être poursuivi sur les biens propres de l’auteur de la dette mais aussi sur les biens communs. Il s’agit du droit de gage des créanciers.
Afin de limiter l’engagement des biens communs pour toute dette contractée par un époux dans le cadre de son activité professionnelle, il est possible d’adopter un statut assurant une séparation entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel.
- L’entrepreneur individuel :
Les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel ont la faculté de poursuivre le paiement des dettes sur les seuls actifs du patrimoine professionnel.
Exception : accord exprès du conjoint à l’engagement de biens communs, souscription de sûretés réelles (hypothèques, nantissement, gage) ou d’une renonciation à la séparation des patrimoines (article L. 526-25 du Code de commerce).
Exemple : l’entrepreneur peut consentir un nantissement sur un bien commun en garantie d’une dette professionnelle, le consentement de l’époux sera toutefois nécessaire.
En vertu de l’article L. 526-1 du code de commerce, la résidence principale du chef d’entreprise échappe au droit de gage des créanciers professionnels, elle est de plein droit insaisissable.
- L’associé d’une société à responsabilité illimitée (SNC, SCS) :
En principe, lorsqu’un époux commun en biens exerce son activité professionnelle par le biais d’une société à responsabilité illimitée qu’il détient, il engage ses biens propres et les biens communs.
Exception : les gains et salaires de son conjoint par application des articles 1413 et 1414 du Code Civil.
- L’associé d’une société à responsabilité limitée (SARL ou SAS)
La responsabilité de l’associé commun en biens est limitée au montant de son apport, ce qui est de nature à préserver les biens communs.
Exception : engagement de caution du gérant associé, ou en cas de faute de gestion, le droit de gage du créancier est étendu aux biens propres de l’époux et aux biens communs.
⇒ Pour résumé, le chef d’entreprise marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts prend le risque d’engager des biens communs pour les dettes contractées dans le cadre de son activité. Toutefois, il existe des moyens de réduire ses risques, en optant pour la forme juridique de société plus adaptée aux époux ou en modifiant de régime matrimonial.
La dissolution de la communauté
La communauté prend fin principalement dans les circonstances suivantes : le divorce ou le décès d’un époux.
♦ En cas de divorce :
Pour liquider la communauté, chacun des époux doit d’abord reprendre ses biens propres puis établir un compte des récompenses, c’est-à-dire un état des créances et dettes que chaque époux détient à l’égard de la communauté.
Ainsi, la communauté doit une récompense à un époux toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres (article 1433 du Code civil).
A l’inverse, un époux doit une récompense à la communauté toutes les fois qu’il a tiré un profit personnel des biens de la communauté.
♦ En cas de décès :
En cas de décès de l’entrepreneur individuel : en l’absence de testament, l’entreprise est dévolue aux héritiers appelés par la loi.
En cas de décès du conjoint associé :
- d’une société civile (ex SARL) : les parts sociales sont dévolues aux héritiers appelés par la loi. Le conjoint survivant peut se faire attribuer les parts sociales et prendre la qualité d’associé (sauf clauses d’agrément prévues au statut).
- d’une société par actions (ex : SAS) : la transmission est réalisée entre les héritiers appelés à la loi. Le conjoint survivant peut également se faire attribuer les actions et prendre la qualité d’actionnaire.
Les alternatives
Pour éviter les contraintes liées au régime de la communauté réduite aux acquêts, les époux peuvent opter pour un régime matrimonial plus adapté en concluant un contrat de mariage.
Le code civil autorise l’adoption par contrat de mariage, des régimes matrimoniaux suivants :
- la communauté d’acquêts aménagée : les époux adoptent le régime de la communauté de meubles et d’acquêts ou le régime de la communauté réduite aux acquêts en modifiant certaines clauses.
- la communauté de meubles et acquêts : les biens acquis par l’un ou l’autre des époux depuis le jour du mariage ainsi que les biens mobiliers appartiennent aux époux quelle que soit la date d’acquisition. Les biens immobiliers acquis par l’un ou l’autre des époux avant le mariage appartiennent en propre à l’époux concerné.
- la communauté universelle : tous les biens (mobiliers ou immobiliers, présents et à venir) sont communs.
- la séparation de biens pure et simple : les patrimoines des époux restent séparés. Chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. L’époux est seul engagé lorsqu’il contracte une dette seule, sauf s’il s’agit d’une dette liée à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
- la participation aux acquêts : pendant le mariage, tout se passe comme si les époux étaient mariés sous un régime de séparation de biens ; à la dissolution, chacun des époux a droit à une somme égale à la moitié de l’enrichissement réalisé par chacun des époux durant le mariage.
Pour établir ou modifier un contrat de mariage, il est obligatoire de s’adresser à un notaire, seul habilité à faire les démarches. Le notaire pourra également vous conseiller sur le choix du régime matrimonial le plus adapté à votre situation de chef d’entreprise.