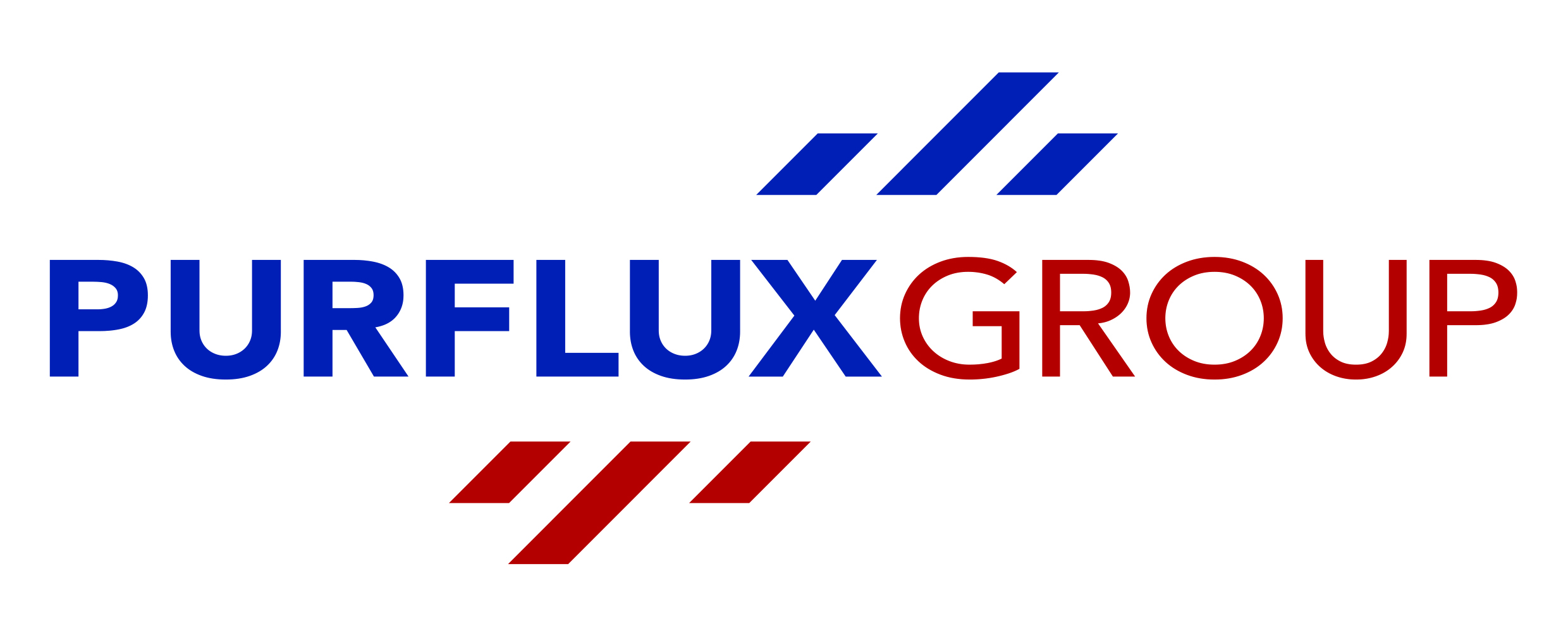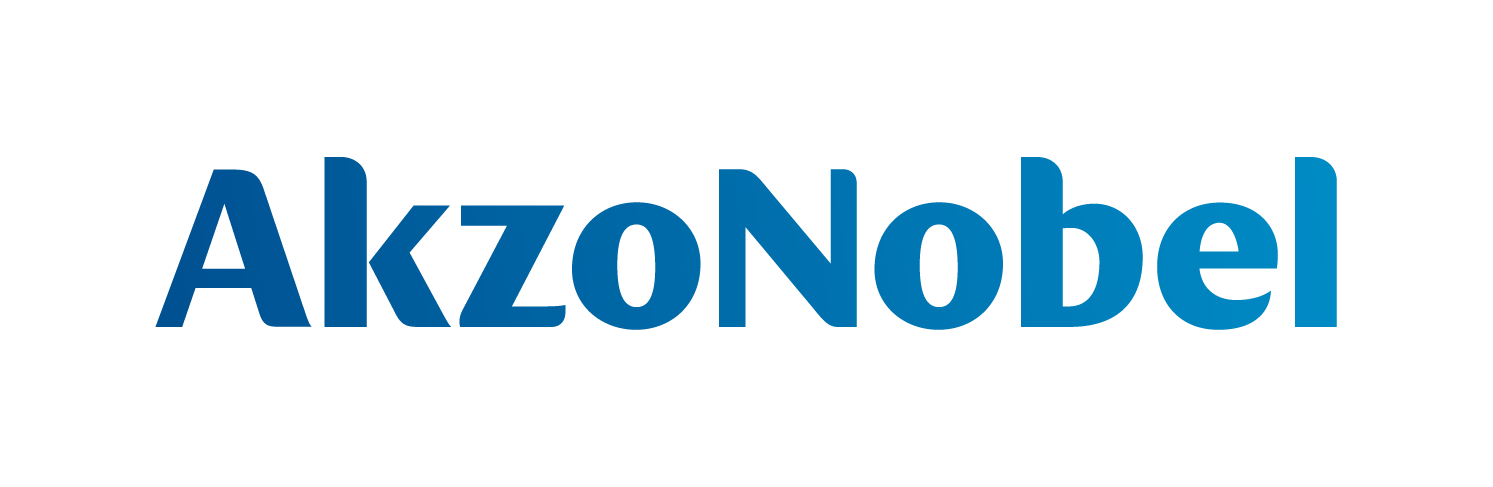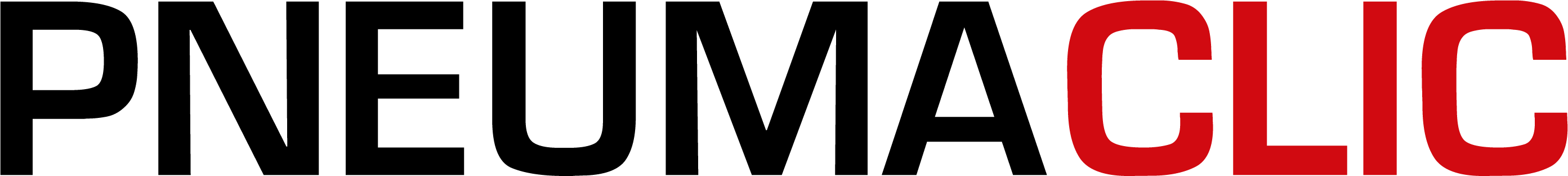L’activité de dépollution de véhicules hors d’usage est exposée à un risque incendie plus élevé que d’autres installations du groupe métier « Déchets ». Selon un rapport du Bureau d’analyse des risques et des pollutions industriels (Barpi), un incendie est recensé dans 90 % des événements de l’activité de dépollution de VHU.
Un incendie dans un centre VHU est d’une extrême gravité puisqu’il entraine une dégradation de la qualité de l’air pouvant menant à une interruption de la circulation et à la mise en place d’un périmètre de sécurité. Cet évènement cause également des dommages matériels et des pertes d’exploitation non négligeables.
Afin de tenir compter de l’accidentologie du secteur et mieux prévenir le risque incendie, l’arrêté du 22 décembre 2023 renforce les obligations des exploitants de centres VHU en matière de prévention du risque incendie.
La mise en place d’un système de détection et de surveillance de départ d’incendie
A compter du 1er janvier 2026, chaque centre VHU devra être équipé d’une détection automatique de départ d’incendie et d’une transmission automatique des alertes.
L’équipement doit permettre d’assurer l’alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site, notamment grâce à l’actionnement d’une alarme.
La détection automatique peut être intégrée au dispositif d’extinction automatique déjà présent sur le site.
En cas d’absence du personnel sur le site lors du déclanchement de l’alarme (ex : fermeture du site), le système doit pouvoir retransmettre l’alerte de manière automatique à une personne externe, formée et désignée par l’exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance.
Cette personne doit pouvoir visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d’incendie, et alerter dans les meilleurs délais l’exploitant et les services d’incendie et de secours.
En cas d’impossibilité technique pour confirmer à distance le départ d’incendie, une levée de doute doit être effectuée dans les 15 minutes (délai maximum) suivant le début de l’alerte.
L’organisation de rondes
Afin de détecter au plus tôt un départ d’incendie, des rondes sont organisées à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site.
En cas de présence permanente sur le site, des rondes régulières devront être effectuées dans l’ensemble des zones en dehors des périodes de tri ou de traitement des VHU.
Il appartient à l’exploitant du centre VHU de déterminer les consignes concernant :
– la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ;
– le parcours des rondes et les points d’observation ;
– la formation du personnel concerné ;
– le matériel adapté à la détection précoce d’incendie avec lequel les rondes sont effectuées et sa maintenance lorsqu’il n’y a pas de système de détection fixe ;
– les actions à entreprendre selon des critères définis préalablement et visant à éviter tout départ de feu ou à en limiter les conséquences au minimum.
Le retrait des batteries
Une zone de stockage temporaire est affectée aux VHU accidentés ou présentant un risque d’incendie, entiers ou non et ce, jusqu’au retrait des batteries de puissance et de démarrage.
Lors de la dépollution d’un VHU, les batteries sont retirées en priorité.
Le retrait de la batterie est réalisé dans un délai d’un mois à compter de l’entreposage du VHU.
L’opération s’effectue comme suit :
- Pour tous les VHU, avant le retrait de la batterie ou des batteries de puissance :
- la batterie de démarrage, d’éclairage et d’allumage est déconnectée dès réception du véhicule ;
- un contrôle de sécurité des batteries de puissance est réalisé immédiatement par du personnel habilité
- Pour les VHU accidentés :
- les batteries de démarrage et de puissance sont retirées avant la fin du premier jour ouvré suivant la réception du véhicule, sauf si le démontage de la batterie est impossible en moins de quatre heures ;
- après enlèvement, les batteries issues de ces VHU sont stockées séparément des autres batteries.
Certaines opérations doivent être effectuées par un personnel doté d’une habilitation électrique. Le CFPA, organisme de formation de la FNA, destiné aux professionnels du secteur automobiles dispense des formations préalables à l’habilitation électrique : B0L, BCL, B2VL, B1XL/B2XL.
Le stockage de batterie et zone d’entreposage temporaire
Après leur retrait, les batteries doivent être entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, conçus de manière à empêcher l’entrée d’eau, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux doivent présenter une résistance au feu au moins R60.
Le stockage des batteries sur le site ne doit pas excéder six mois.
Chaque centre VHU dispose d’une zone d’entreposage tampon du processus de tri. Cette zone doit être vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ou munie d’un système d’extinction automatique.
On distingue :
– les zones d’entreposage temporaire en amont du tri d’un volume maximal de 20m3.
– les zones d’entreposage temporaire sous cabine de tri d’un volume maximal de 120 m3.
Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d’entreposage tampon, sont munis d’un système de détection automatique et d’alarme incendie.
Pour toute installation nouvelle, le dossier d’autorisation doit comporter une étude technico-économique sur la faisabilité et l’efficacité d’une zone d’immersion. Cette zone d’immersion doit être située à proximité immédiate de la zone de stockage temporaire.
L’ilotage et extinction automatique
Les déchets combustibles ou inflammables doivent être entreposés dans une zone spécifique.
L’arrêté distingue :
- L’îlot : zone délimitée par des parois ou par un marquage au sol, dont la surface au sol n’excède pas 500 m2 ;
- Petit îlot : zone susceptible de contenir des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
– le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à dix m3 si elle est située dans un bâtiment ouvert ou fermé, et à 30 m3 pour les autres cas ;
– les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur…) ;
– la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d’au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.
Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots pour l’ensemble des entreposages extérieurs.
Lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont entreposés dans des îlots, l’article 9 de l’arrêté précise la configuration géométrique et technique des ilots :
– tout point est situé à moins de dix mètres d’une face accessible par les services d’incendie et de secours sur au moins une face
– la hauteur maximale d’entreposage est égale à 6m
– les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d’au moins 5 m
– les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d’au moins 5m
– les îlots équipés d’un système d’extinction automatique d’incendie complété par des moyens automatiques fixes de refroidissement installés sur les parois externes du bâtiment
Le plan de défense contre l’incendie et la maitrise du sinistre
Un plan de défense contre l’incendie doit être réalisé, tenu à jour et transmis aux services d’incendie et de secours. Le plan de défense est mis à disposition à l’entrée du site et comprend :
– les schémas d’alarme et d’alerte décrivant les actions à mener par l’exploitant à compter de la détection d’un incendie (l’origine et la prise en compte de l’alerte, l’appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ;
– l’organisation de la première intervention et de l’évacuation face à un incendie en périodes ouvrées (lundi au vendredi, hors jours fériés) ;
– les modalités d’accueil des services d’incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l’arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;
– les modalités d’accès pour les services d’incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d’accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu’ils n’aient pas à forcer l’accès aux installations en cas de sinistre ;
– le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d’alimentation, la localisation et l’alimentation des différents points d’eau, l’emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d’un incendie ;
– le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, des bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;
– le plan d’implantation des moyens automatiques de protection contre l’incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leur attestation de conformité ;
– les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l’état des matières stockées sont tenus à disposition du service d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d’en découler ;
– la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d’alerte, d’intervenir avant l’arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d’entraînement ;
-les plans de l’installation précisant l’emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones de stockage temporaire, des zones d’entreposage tampon, des zones d’immersion, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes.
Depuis le 1er juillet 2024, tout exploitant doit organiser un exercice de défense contre l’incendie. Cet exercice est renouvelé tous les 3 ans. Pour les nouvelles installations, le premier exercice a lieu dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation.
Chaque exercice fait l’objet d’un compte-rendu conservé pendant 5 ans et mis à disposition de l’inspection des installations classées et des services de secours.
Le plan de prévention doit être communiqué aux opérateurs, intervenants ainsi qu’au personnel interne ou externes afin qu’ils puissent connaitre les risques des installations et la conduite à tenir, ainsi que les moyens d’intervention à employer en cas de sinistre.
Une formation doit être dispensée aux personnes susceptibles de mettre en œuvre ces moyens d’intervention.
A titre complémentaire, vous pouvez consulter le dossier sur la démarche globale de prévention du risque établi par l’INRS: Incendie sur le lieu de travail.