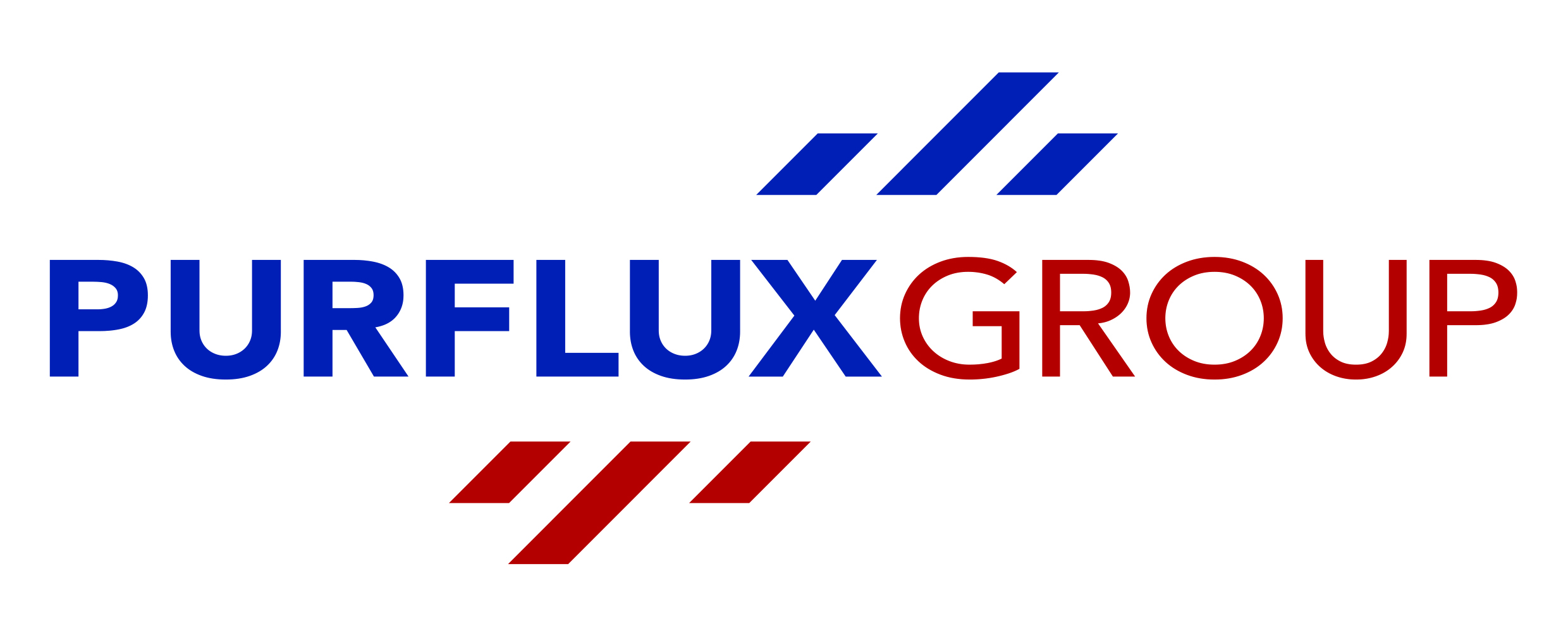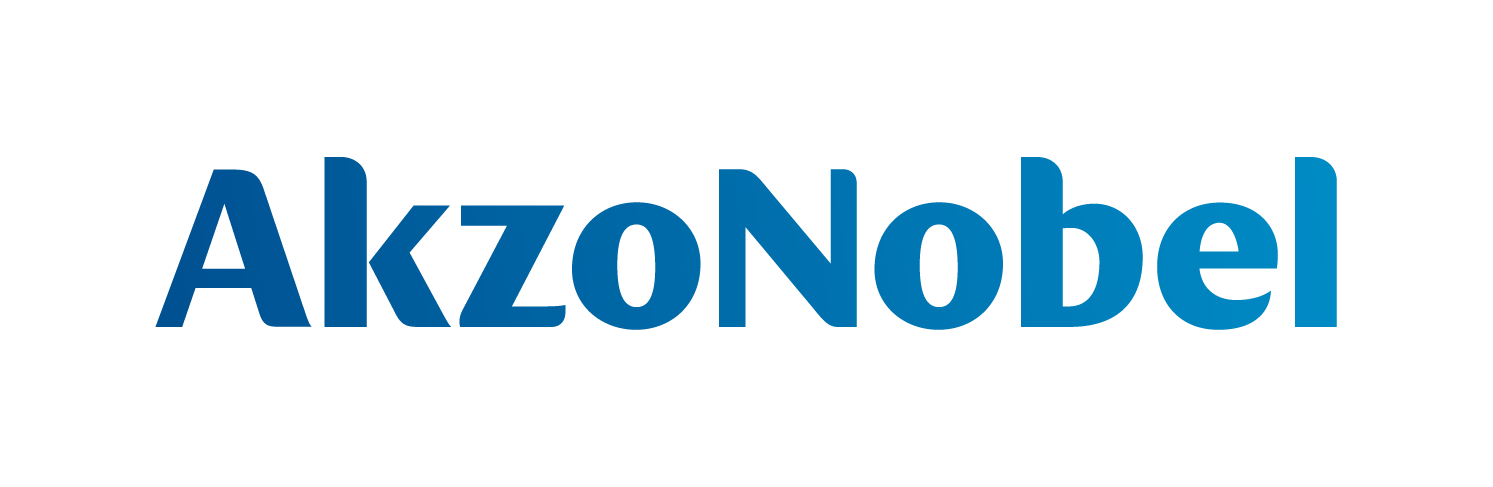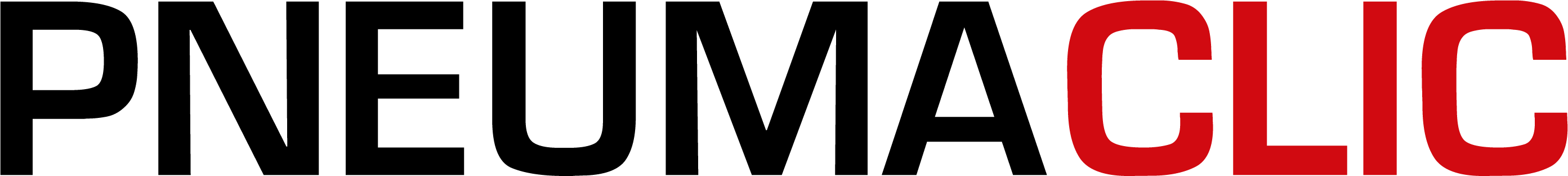Contexte européen : vers une harmonisation du marché des pièces visibles
Depuis près de 25 ans, la protection des pièces de rechange automobiles visibles (éléments de carrosserie, phares, vitrages, rétroviseurs, etc.) fait l’objet de débats nourris en Europe. L’enjeu : permettre l’ouverture du marché à la concurrence tout en respectant les droits de propriété intellectuelle des constructeurs d’origine notamment les dessins et modèles. Depuis de nombreuses années, la FIEV (Fédération des Industries et des Equipements pour Véhicules) œuvre pour la pleine libéralisation des pièces.
Jusqu’à récemment, en l’absence d’harmonisation européenne, les États membres adoptaient des positions divergentes :
- Certains protégeaient les pièces visibles via le droit des dessins et modèles ;
- D’autres, comme l’Allemagne ou l’Italie, avaient déjà intégré une clause de réparation, autorisant leur libre commercialisation.
Ce n’est qu’avec la Directive (UE) 2024/2823 du 23 octobre 2024 que l’Union européenne a engagé l’harmonisation de ce cadre juridique. Toutefois, son application complète ne sera obligatoire qu’à compter de décembre 2032, laissant aux États membres une période de transition.
Une ouverture progressive du marché en France
En France, le virage législatif a été amorcé plus tôt, avec l’adoption de la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021, effective depuis le 1er janvier 2023. Cette loi a :
- Réduit la durée de protection des dessins ou modèles des pièces visibles de 25 à 10 ans ;
- Ouvert le marché à la concurrence, mais selon un régime différencié :
- Pour les pièces de vitrage : ouverture totale à tous les équipementiers ;
- Pour les autres pièces visibles : seules les pièces produites par les équipementiers d’origine (livrant les constructeurs en première monte) peuvent être commercialisées en concurrence directe avec les constructeurs.
Une clarification essentielle par la Cour de cassation
Malgré ce nouveau cadre législatif français, certains constructeurs automobiles ont tenté de restreindre la portée de la réforme. Le principal argument avancé fut que les dispositions issues de la loi Climat ne s’appliqueraient qu’aux dessins ou modèles enregistrés à partir du 1er janvier 2023.
Une telle lecture aurait eu pour effet de maintenir la protection juridique exclusive sur la grande majorité des pièces existantes et enregistrées avant 2023.
Dans un arrêt du 11 juin 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a mis fin au débat.
Principaux apports de l’arrêt :
1.Confirmation du principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce :
La loi Climat a institué un régime exonératoire de responsabilité pénale pour les équipementiers d’origine. Conformément aux principes du droit pénal, cette loi plus douce s’applique immédiatement y compris aux dessins ou modèles enregistrés avant 2023.
2.Libéralisation pleinement effective des pièces visibles :
Les équipementiers d’origine peuvent commercialiser librement leurs pièces visibles, sans risque d’être poursuivis pour contrefaçon. Toute la chaîne commerciale (distributeurs, réparateurs, revendeurs) bénéficie de cette même protection.
3.Proportionnalité de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle :
La Cour rappelle que la réforme poursuit un objectif d’intérêt général : favoriser la réparabilité des véhicules et réduire leur mise au rebut prématurée.
Motivation de la décision de la Cour de cassation :
« L’exonération de responsabilité pénale de l’équipementier d’origine concerne les pièces qu’il fabrique et peut donc librement céder. Les participants à la chaîne commerciale (…) ne peuvent donc être poursuivis. Une lecture contraire de la loi la rendrait inutile. »
« Les dispositions modifiant l’article L.513-6 du Code de la propriété intellectuelle portent une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi : l’ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées visibles. »
L’arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans un mouvement européen plus large. D’ici décembre 2032, tous les États membres devront se conformer à la Directive 2024/2823, qui consacre enfin la clause de réparation dans l’UE.
En attendant, la France, en clarifiant les conditions d’application de sa législation, offre une sécurité juridique précieuse aux acteurs de la filière tout en favorisant un marché plus ouvert et plus compétitif.