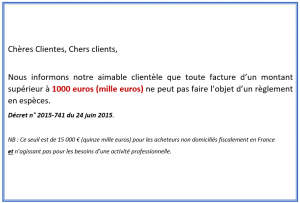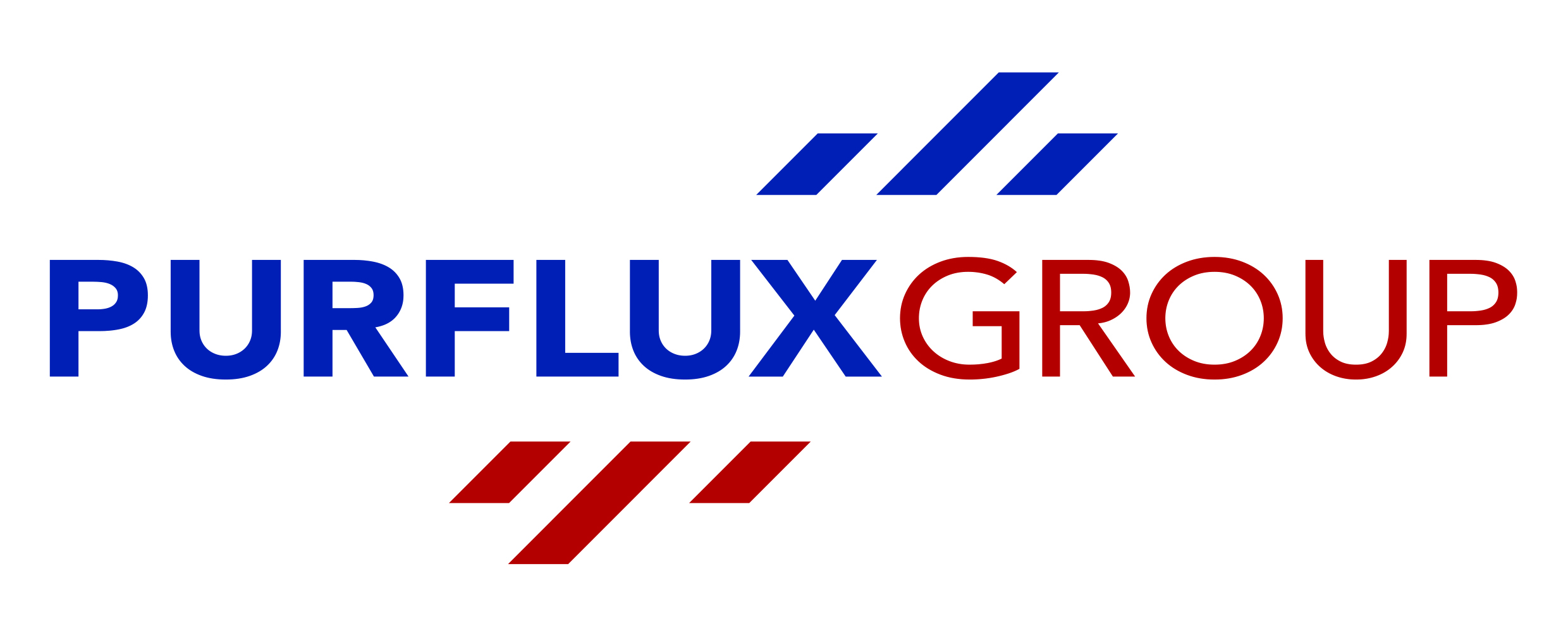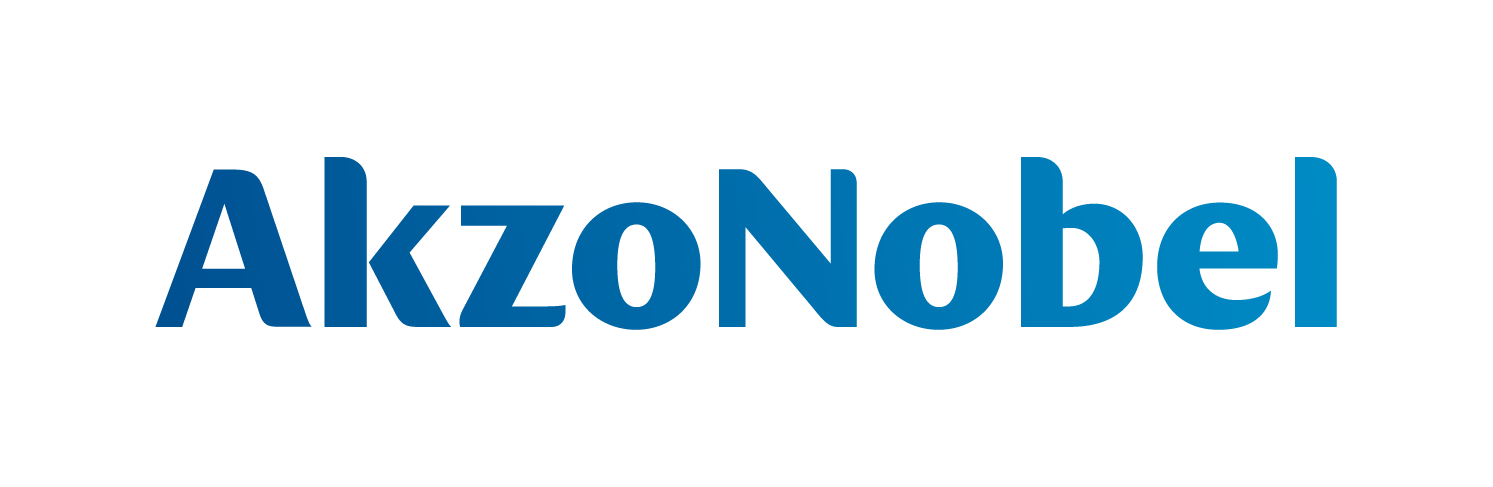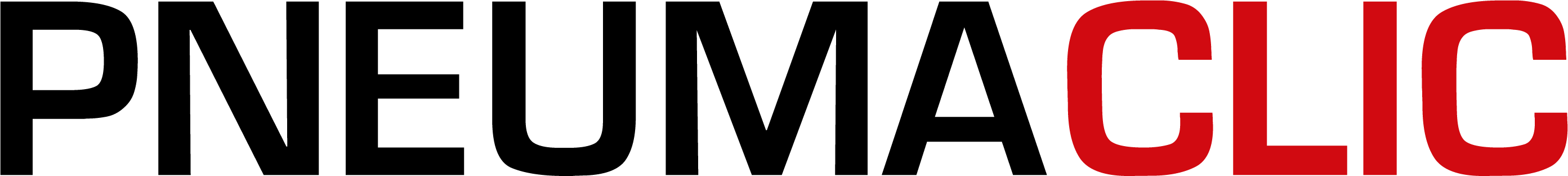Les risques d’impayés sont permanents dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle. Il est essentiel de connaître quels sont vos droits, mais aussi vos obligations vis-à-vis de votre débiteur. Les litiges peuvent avoir de nombreuses causes (litiges nés d’un différend sur l’exécution de votre prestation, insolvabilité du débiteur, mauvaise foi …).
Le législateur a mis en place un arsenal de procédures amiables ou judiciaires destiné à vous aider à faire face à ces situations. Vous privilégierez l’une ou l’autre procédure en fonction de la situation du débiteur, voire du montant du litige.
Cette note vous permet de savoir comment réagir face à un chèque sans provision.
UN CHEQUE SANS PROVISION : COMMENT REAGIR ?
Définition du chèque: écrit par lequel son titulaire (le tireur) donne l’ordre à sa banque (le tiré) de remettre à un tiers bénéficiaire (le porteur), sur présentation de cet écrit, une somme déterminée, lui appartenant et disponible.
Les délais d’encaissement du chèque
Les durées de validité (délai passé lequel la banque n’a plus à payer le chèque, même s’il était provisionné) :
- 1 an et 8 jours pour un chèque bancaire (émis en métropole 3)
- 1 an pour un chèque postal.
Les conditions d’acceptation d’un chèque par le commerçant
Le refus d’un chèque est possible :
Le chèque est un instrument de paiement largement accepté mais il n’est pas obligatoire, sauf dans certains cas. Ainsi, un commerçant peut refuser un paiement par chèque ou ne l’accepter qu’au-delà d’un certain montant minimal, car le chèque n’équivaut pas à une monnaie ayant cours légal. Si vous prenez cette décision de limiter le recours aux chèques, vous devez en informer votre clientèle par voie d’affichage au niveau des caisses.
Attention : depuis le 1er septembre 2015, aucun paiement en espèce ne peut être accepté au-delà d’un montant de 1000 €.
Vérifications opérées par le professionnel
- Justification d’identité en cas de paiement par chèque
Le professionnel peut exiger la présentation d’un ou de plusieurs documents officiels avec photo en contre partie de la remise d’un chèque. En ne réclamant pas cette pièce officielle, il engagerait sa responsabilité à l’égard du titulaire du compte dont le chéquier aurait été dérobé4.
- Consultation du Fichier national des chèques irréguliers (FNCI)
Lors de la remise d’un chèque pour paiement d’un bien ou d’un service, son bénéficiaire (le professionnel ou le particulier) a la possibilité de vérifier la régularité de l’émission du titre, par consultation du FNCI géré par la Banque de France. Il va s’assurer que le chèque remis n’a pas été déclaré comme volé ou perdu, tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d’une interdiction bancaire ou judiciaire.
Pour le consulter, vous pouvez demander un code d’accès à la BDF.
L’INTERDICTION BANCAIRE POUR EMISSION D’UN CHEQUE SANS PROVISION
Nous verrons ici deux cas de figure. Celui du consommateur qui émet un chèque sans provision et celui du professionnel dans le cadre de son activité.
Généralités
L’émission d’un chèque sans provision n’est plus un délit, mais il s’agit d’un évènement sérieux car le rejet entraîne immédiatement l’inscription de l’émetteur au Fichier Central des Chèques (FCC) et une interdiction pour lui (et éventuellement les autres co-titulaires) d’émettre des chèques pour une durée de 5 ans.
Le compte est suffisamment approvisionné si la Banque dispose sur le compte de la somme nécessaire au paiement présenté. La provision est soit le solde créditeur, soit l’autorisation de découvert autorisé.
Réaction de la Banque : Obligation d’information préalable à l’envoi d’une lettre d’injonction
Avant de refuser le paiement du chèque, la Banque doit informer son client « par tout moyen approprié » le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision. La loi ne fixe pas de délai de prévenance avant le rejet effectif du chèque. Un délai de 24 ou 48 h est souvent pratiqué.
Si pendant ce délai, le client ne réagit pas, la Banque lui adresse alors (et ce à chaque rejet de chèque) une lettre d’injonction de ne plus émettre de chèques. Envoyée en AR, cette lettre informe sur la portée de l’interdiction, sur ses conséquences et sur les moyens pour y remédier. Les co-titulaires ou mandataires inscrits sur le compte sont également concernés.
Interdiction bancaire
Dans les deux jours qui suivent le rejet, la banque signale l’incident à la BDF, qui recense tous les autres comptes et informe les établissements bancaires de la mise en place de l’interdit. Tout professionnel constatant l’interdiction, pourra refuser un chèque.
Si l’interdiction bancaire concerne un professionnel
- Cas où l’interdiction concerne un entrepreneur en son nom propre
Si vous exercez une activité en nom propre, c’est-à-dire en tant que personne physique, et que vous êtes concerné par une interdiction d’émettre des chèques, cette interdiction s’étend également à tous les comptes au même nom et donc votre compte personnel.
- Cas où l’interdiction concerne un entrepreneur en société :
Si vous exercez votre activité professionnelle en société, c’est-à-dire en tant que personne morale, cette interdiction va s’étendre uniquement à la société sur la référence de votre numéro de SIRET.
Comment régulariser une interdiction bancaire ?
Le titulaire du compte bénéficie de la possibilité permanente de recouvrer le droit d’émettre des chèques, s’il procède à la régularisation de l’incident.
- Une nouvelle présentation du chèque :
Si le client se reconstitue une provision suffisante, il peut vous contacter pour vous informer que vous pouvez à nouveau déposer le chèque litigieux. Vous serez alors payé et le client aura comme justificatif son relevé bancaire.
- La restitution du chèque
Le client peut également prendre directement contact avec vous afin de vous régler via un autre moyen de paiement. Une fois le paiement effectif, vous devrez lui restituer le chèque afin qu’il puisse le remettre à sa banque. Le chèque constitue pour lui la seule preuve de la régularisation.
- Le blocage de la provision
Le client peut demander à sa banque de bloquer la provision du chèque impayé. Cette provision est alors exclusivement destinée à vous payer. Tant que le chèque ne sera pas présenté, le blocage sera maintenu jusqu’à la date limite de sa validité. Cette solution est préconisée lorsque le bénéficiaire n’est plus en possession du chèque.
Le coût d’une interdiction d’émettre des chèques :
- Les frais de traitement prélevés par la banque du débiteur
Les frais de traitement prélevés par la banque sont encadrés par la loi :
Ces frais sont limités à 30€ par chèque pour les rejets de chèques d’un montant inférieur ou égal à 50€.
Ces frais sont limités à 50 € pour les rejets de chèques d’un montant supérieur à 50€.
Dans ces frais sont compris la facturation des divers courriers relatifs à l’incident de paiement et adressés par la banque. A noter que le rejet d’un chèque présenté à plusieurs reprises dans les 30 jours qui suivent le premier rejet constitue un incident de paiement unique.
- Vous n’avez plus à payer des pénalités libératoires au Trésor public
La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a supprimé les pénalités libératoires dues au Trésor Public.
Les effets de la levée de l’interdiction bancaire :
Lorsque la situation est régularisée, la banque doit en informer la BDF dans les deux jours qui suivent la présentation des justificatifs. Elle doit également adresser une attestation de régularisation.
VOUS RECEVEZ UN CHEQUE SANS PROVISION
Regardez son montant
Lorsque le chèque est inférieur à 15€, la banque est tenue de vous le payer dans le délai d’un mois à partir de la date d’émission, qu’il y ait ou non provision sur le compte.
Lorsque le chèque est supérieur à 15€, la banque vous adresse une attestation de rejet de chèque pour défaut de provision.
A défaut de paiement
A défaut de paiement du chèque dans le délai de 30 jours courant à compter de sa première présentation, ou de constitution d’une provision par l’émetteur dans ce délai, vous pouvez :
- demander à votre banque l’établissement d’un certificat de non-paiement. Elle doit vous l’envoyer dans un délai de 15 jours suivant votre demande,
- effectuer une nouvelle présentation du chèque à l’encaissement. Si cela s’avère infructueux, la banque vous adressera automatiquement un certificat de non-paiement.
| Nom et Prénom
Adresse Ou Raison Sociale Nom de la banque de l’émetteur Adresse A… , le…… Objet : Demande de certificat de non-paiement Madame, Monsieur, Le chèque n° …. d’un montant de …. euros (montant en chiffres et en lettres) établi à mon ordre par (nom et prénom de l’émetteur du chèque) tiré sur …(le nom de la banque de l’émetteur) a été rejeté depuis plus de 30 jours pour insuffisance de provision. Je vous prie donc de bien vouloir m’adresser par retour un certificat de non-paiement afin que je puisse faire éventuellement procéder à une saisie. Vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. Signature |
Procédure de recouvrement
Vous pouvez alors faire notifier le certificat de non-paiement à votre débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou faire appel à un huissier de justice qui signifiera le certificat de non-paiement à l’émetteur du chèque sans provision.
Les deux procédés valent commandement de payer.
Votre débiteur doit apporter la preuve qu’il a payé la somme et les frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification. S’il ne l’a pas fait, l’huissier fait apposer la formule exécutoire sur le certificat de non-paiement : celui-ci a alors la même force qu’un jugement.
L’huissier peut engager toutes les procédures d’exécution forcée (saisie mobilière, saisie sur salaire …) pour récupérer le montant du chèque et tous les frais engagés.
Débiteur interdit bancaire
Si le chèque a été remis par une personne en interdit bancaire, la banque doit le préciser sur l’attestation de rejet.
Si la banque a omis de réclamer à son client la restitution des formules de chèques, elle devra payer le chèque émis sur l’une de ces formules. Vous pouvez obtenir de la banque de l’émetteur, en plus du montant du chèque, l’indemnisation des préjudices causés par l’émission de ce chèque sans provision (frais de rejet du chèque, de saisie, d’exécution que vous avez dus avancer par exemple).
SANCTIONS PENALES
Votre client est passible d’une peine de prison (jusqu’à 5 ans) et/ou d’une amende (jusqu’à 375.000€) :
- s’il émet un chèque malgré une interdiction bancaire : risque d’amende et d’une interdiction judiciaire qui concerne alors sa signature elle-même et vaut donc pour des chèques émis sur des comptes où il serait que mandataire dans le cadre d’une procuration par exemple.
- s’il retire la provision après l’émission d’un chèque.
- s’il fait opposition à un chèque pour un motif illicite (motifs légaux : perte du chèque, vol ou utilisation frauduleuse, redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire).