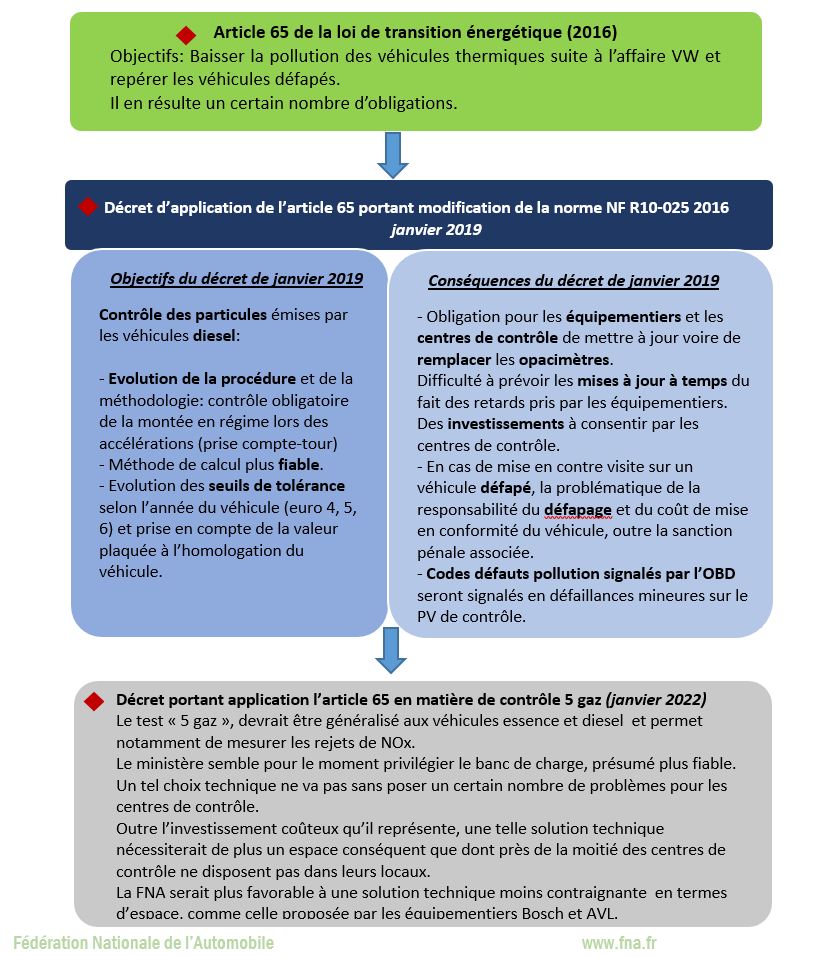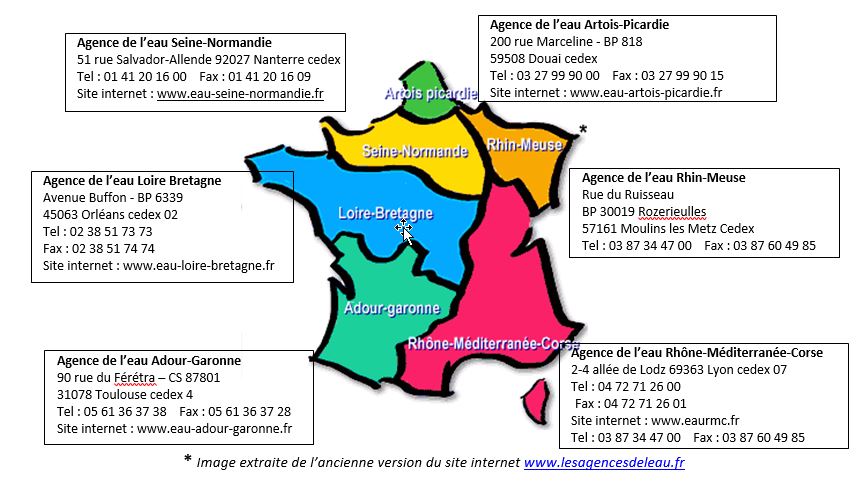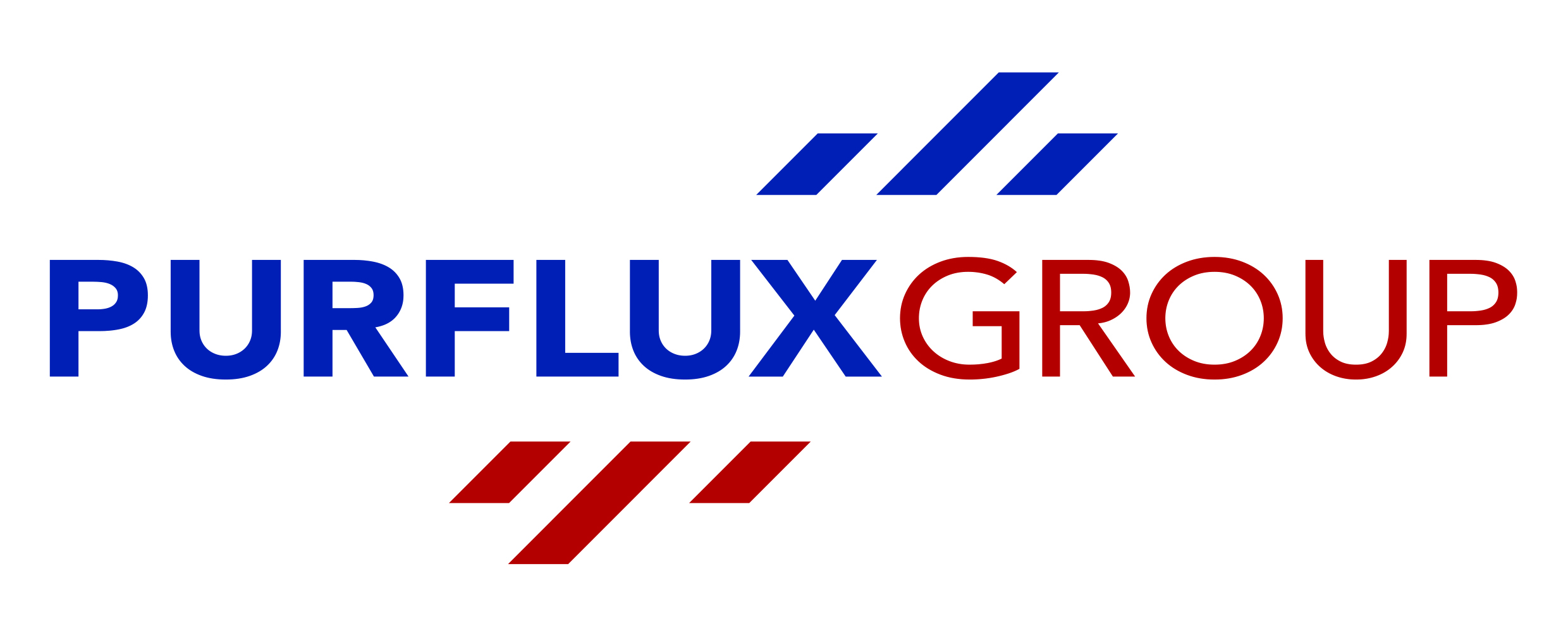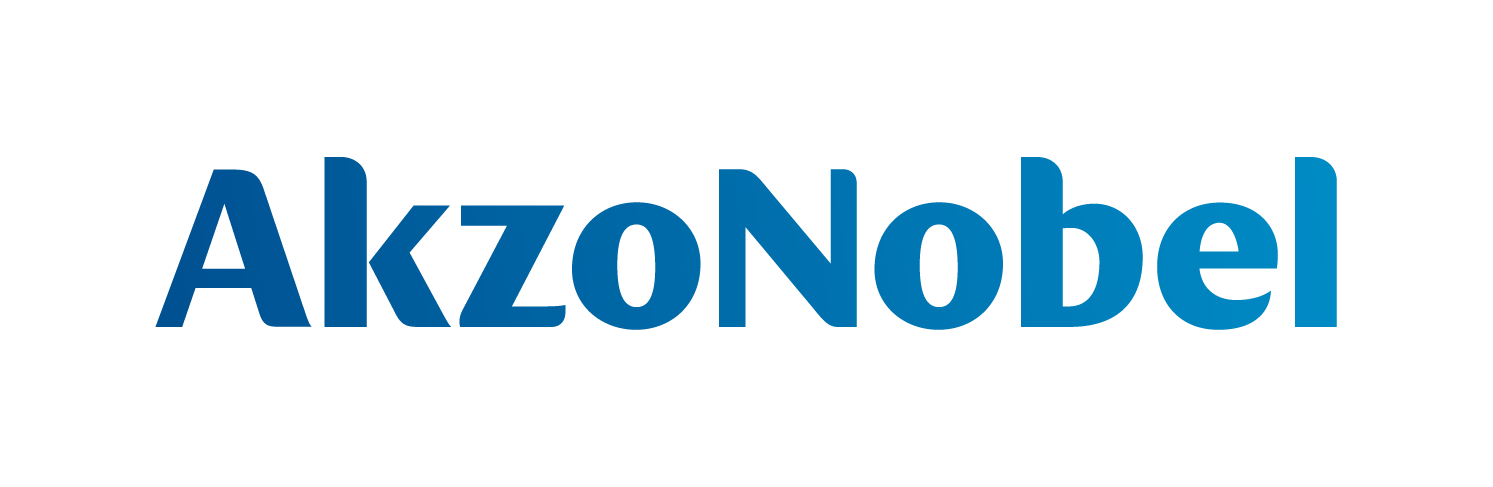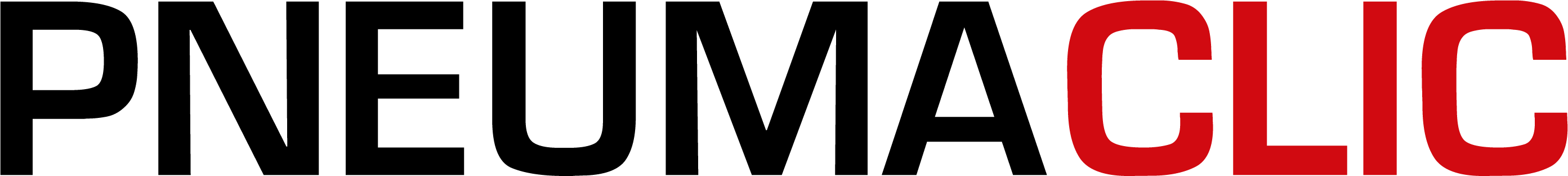Depuis le 1er juillet 2018, pour limiter les nuisances lumineuses, l’éclairage nocturne est désormais restreint pour toutes les publicités, préenseignes, enseignes lumineuses et les bâtiments non résidentiels.
Règles de restriction nocturne :
- les vitrines des magasins de commerce ou d’exposition doivent être éteintes entre 1h et 7h du matin. Elles peuvent néanmoins être éteintes une heure après la fermeture lorsque l’activité se poursuit après 1h du matin et allumées une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce avant 7h du matin,
- publicité et préenseigne lumineuse :
- Agglomération de moins de 800 000 habitants : devront être éteinte entre 1 h et 6 h du matin.
- Agglomération de plus de 800 000 habitants : Règles définies par le règlement local de publicité.
- enseigne lumineuse : extinction entre 1 h et 6 h du matin. Toutefois, les commerces en activité entre minuit et 7 h du matin peuvent allumer leur enseigne une heure avant l’ouverture et la laisser allumée jusqu’à une heure après la fermeture.
- les éclairages intérieurs des locaux à usage professionnel devront être éteints une heure après la fin de l’occupation des locaux,
- les façades des bâtiments non résidentiels devront seulement être éclairées à compter du coucher du soleil et au plus tard jusqu’à 1h du matin.
Attention : Le règlement local de publicité (RLP) peut se substituer très largement aux dispositions présentées ci-dessus en prévoyant des règles plus strictes que la règlementation nationale.
Lorsqu’il est adopté, ce règlement doit être mis à la disposition du public sur le site internet de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
Vous devez rester prudents et bien analyser le règlement local de publicité de votre ville.
| Pour rappel : l’article L. 581-3 du code de l’environnement définit les termes suivants :
Enseigne : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; Préenseigne : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. Publicité : à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités |
Pour les façades d’immeubles non résidentiels et les vitrines des magasins de commerce, des dérogations pourront être accordées par le préfet les veilles de jours fériés et chômés, pendant la période de Noël, ainsi que lors de manifestations locales définies par arrêté préfectoral et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente définies par le Code du travail.
Le non-respect des obligations en matière d’éclairage lumineux est constaté visuellement par le maire. En revanche, le préfet est compétent concernant l’éclairage des bâtiments communaux.
Au terme d’une procédure administrative, le maire ou le préfet peut suspendre, par arrêté, le fonctionnement des sources lumineuses du commerce qui ne s’est pas conforté à la législation. Celui-ci encourt également une amende de 750 euros.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur :
- la page dédiée du site du Ministère de l’Environnement : http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/pollution-lumineuse
- le site de l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN) : https://www.anpcen.fr