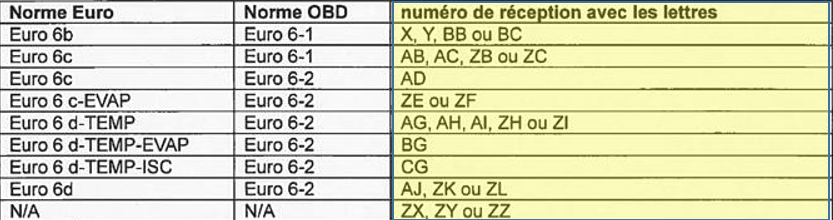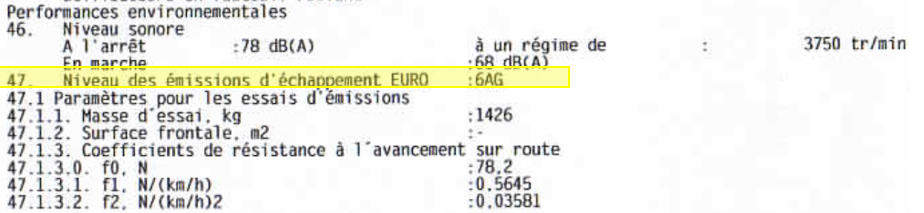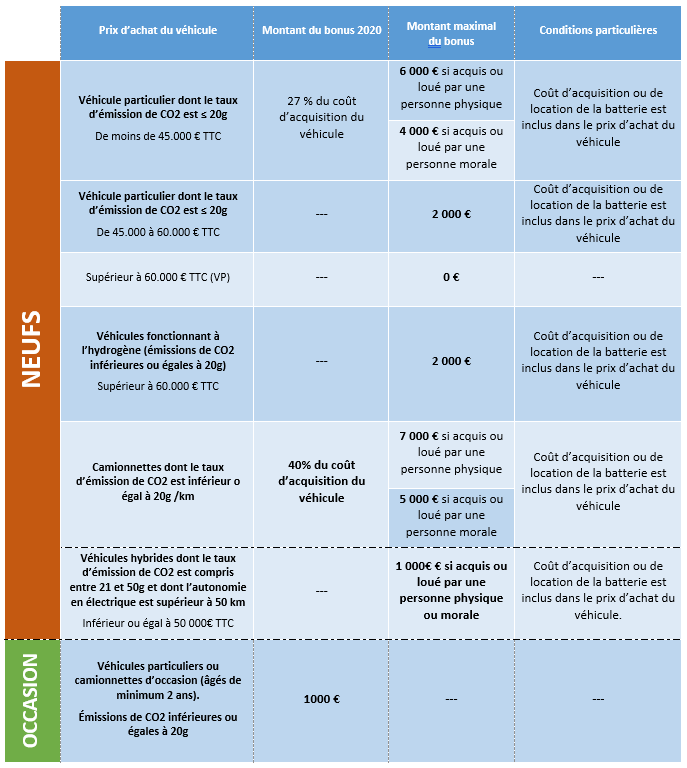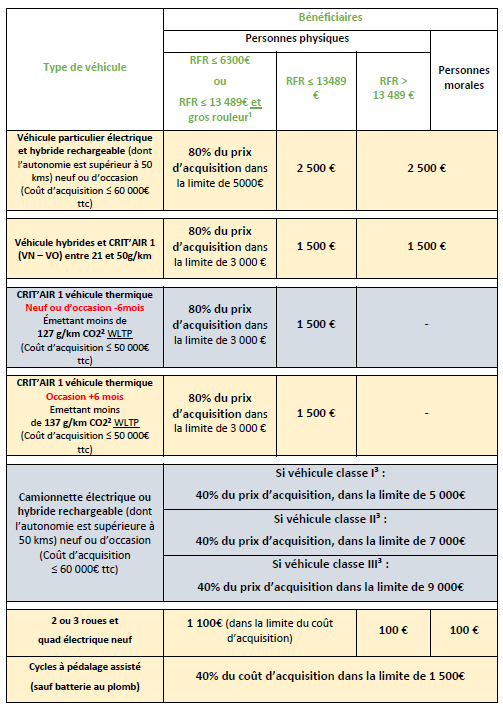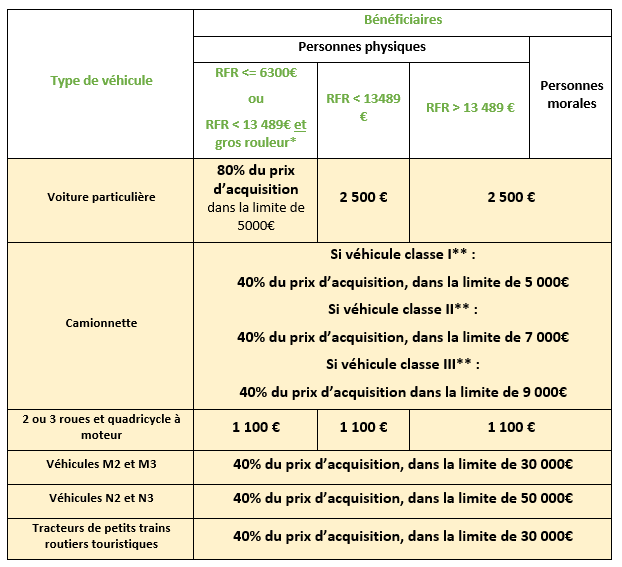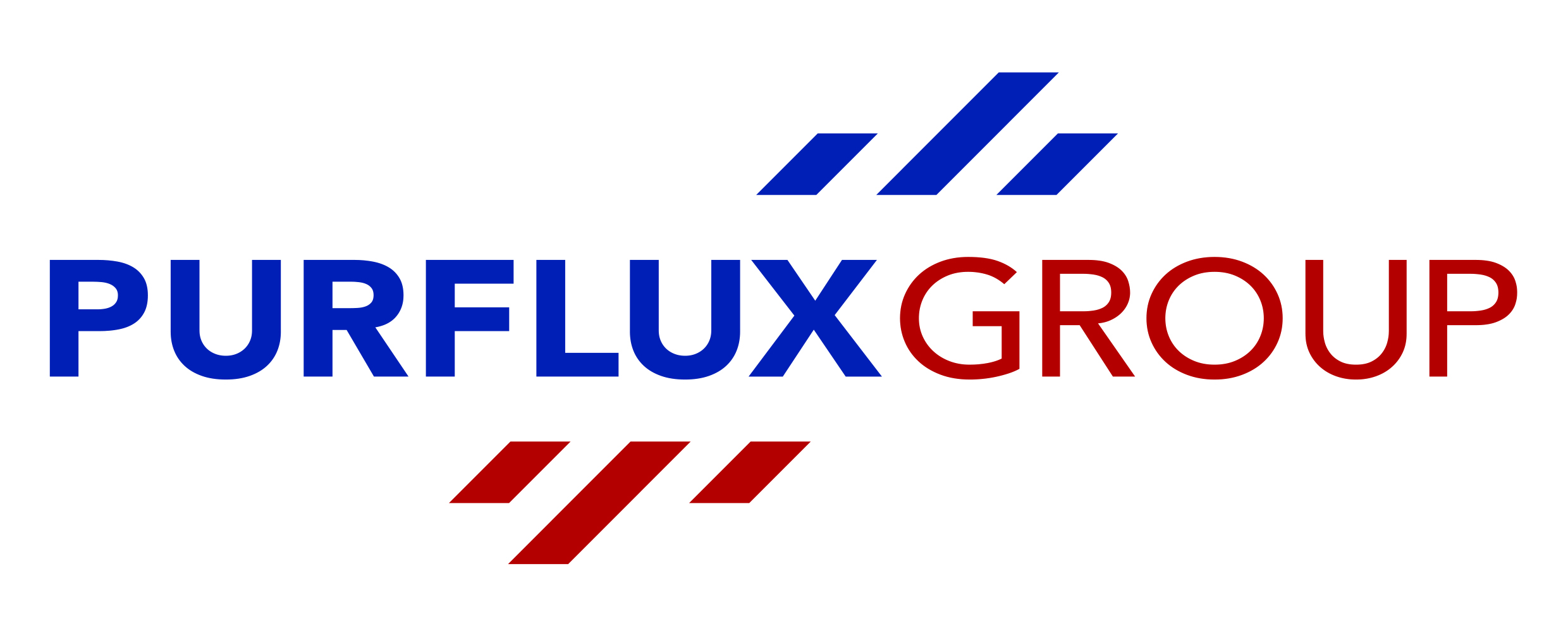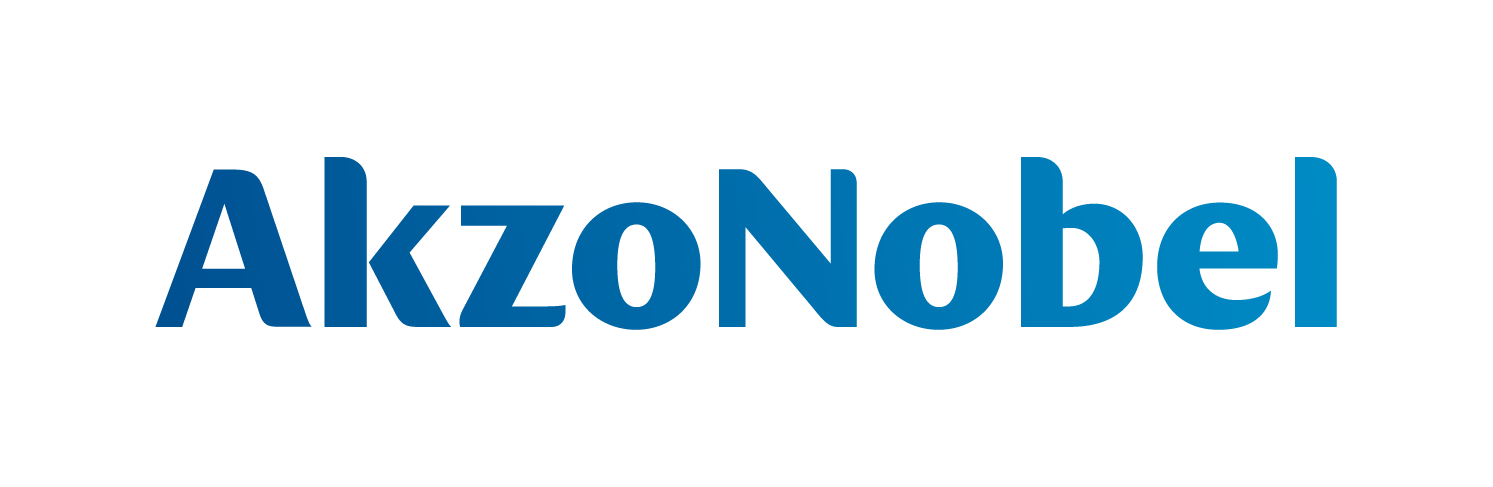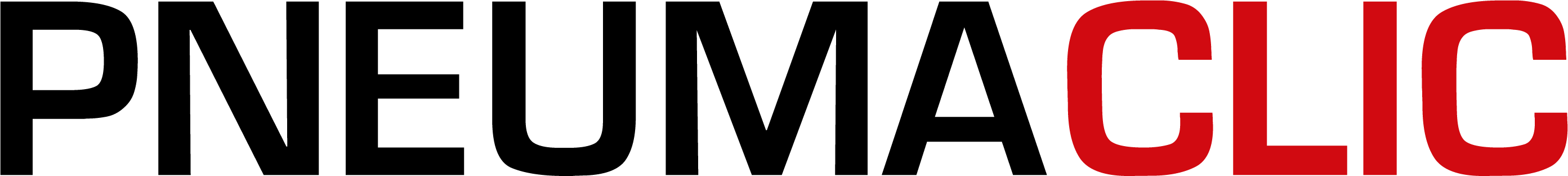Les règles de gestion des déchets exposées ci-après sont applicables à toutes les stations-service, qu’elles soient classées au titre des ICPE ou non.
En vertu de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, chaque entreprise est responsable de l’élimination des déchets qu’elle produit et/ou détient. Elle doit s’assurer que tous les déchets générés par son activité sont éliminés conformément à la réglementation, y compris les déchets suivants :
- les déchets assimilés aux déchets ménagers, même s’ils sont collectés par le service public ;
- les produits usagés issus d’un travail pour un client, dès que celui-ci les lui confie.
La responsabilité du producteur/détenteur de déchets commence dès que le déchet est produit. Elle s’étend jusqu’à l’étape finale d’élimination du déchet, c’est-à-dire son traitement ou sa mise en décharge. La responsabilité du producteur ne cesse pas au moment où il remet ses déchets à un tiers. Elle reste engagée conjointement à celles des tiers qui assurent l’élimination.
Le producteur/détenteur doit assurer la traçabilité de ses déchets par :
- l’émission d’un bordereau de suivi des déchets dangereux qui assure leur traçabilité jusqu’au centre d’élimination, de regroupement ou de pré traitement ;
- la tenue d’un registre de suivi des déchets qui permet de retracer par ordre chronologique les opérations relatives à l’élimination des déchets (production, expédition, réception ou traitement).
Ces documents doivent être conservés, selon les cas, au moins 3 à 5 ans et tenus à disposition des autorités compétentes (DREAL, etc).
Quelles prescriptions pour l’exploitant de la station-service en matière de gestion des déchets ?
- Ils sont stockés, traités et éliminés conformément aux circuits réglementaires de traitement des déchets.
- Leur traçabilité doit être assurée par l’exploitant (déclaration d’élimination et conservation de bordereau de suivi des déchets dangereux-BSDD, tenue du registre).
- Interdiction de brûlage des déchets à l’air libre.
Les contrôles périodiques
Lors du contrôle, l’exploitant doit présenter, sur toute demande, les documents de traçabilité de ses déchets.