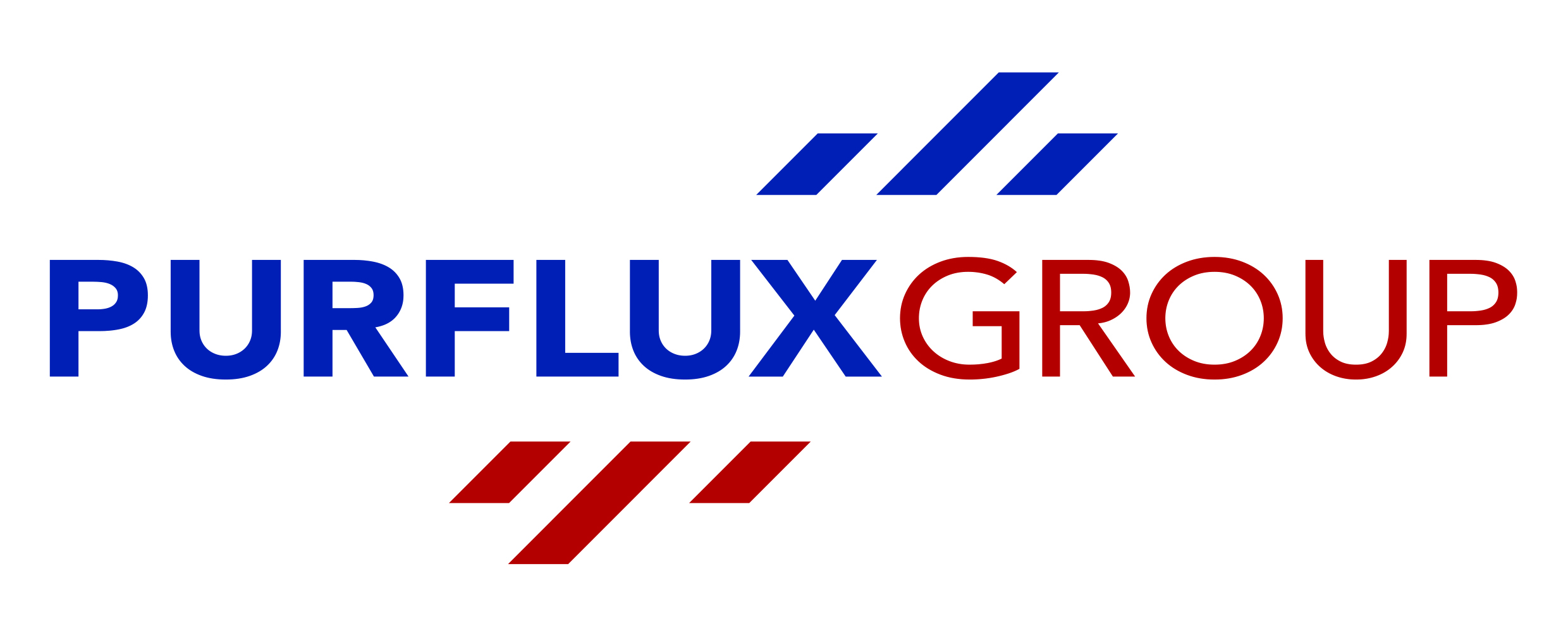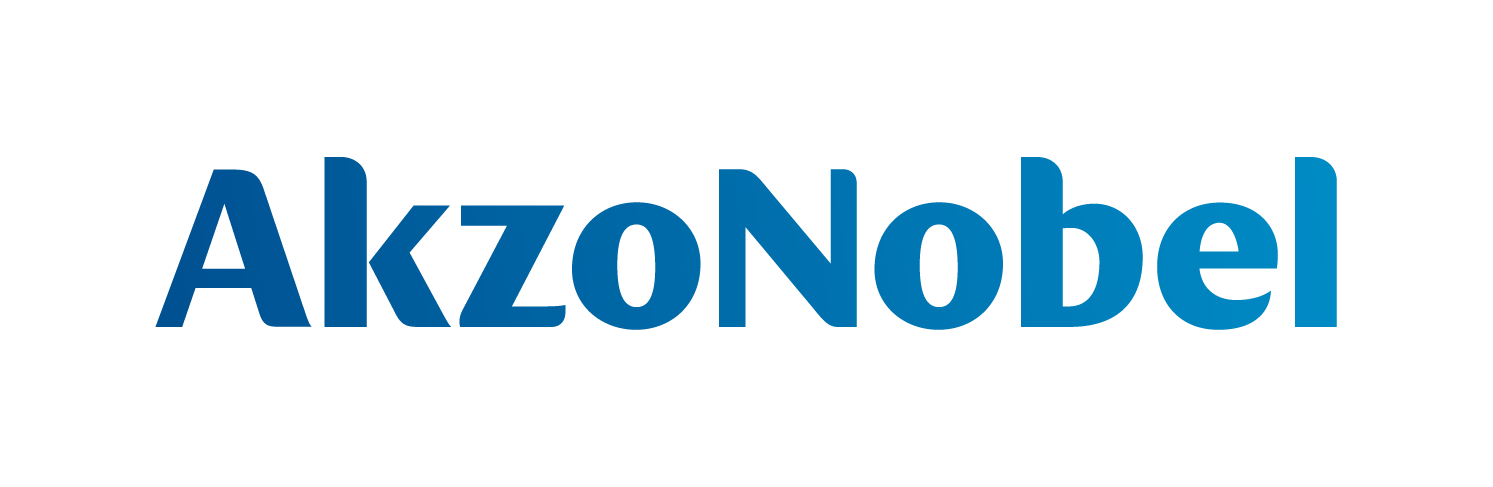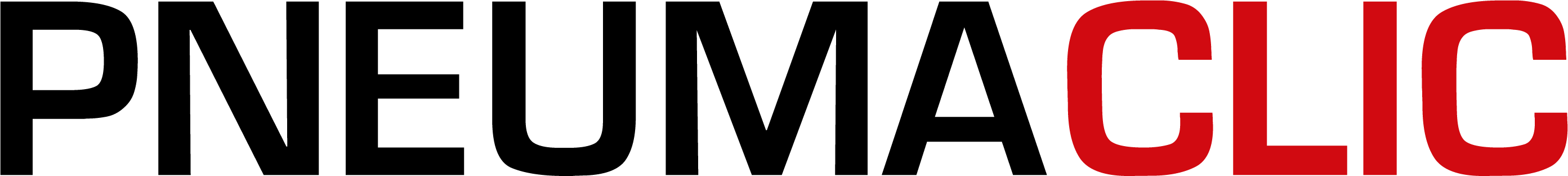La loi du 5 mars 2014 impose aux employeurs de réaliser un entretien professionnel avec leurs salariés au minimum tous les deux ans.
Pour les salariés présents dans l’entreprise en mars 2014, lors de l’entrée en vigueur de la loi, le premier entretien professionnel devait avoir lieu avant le 7 mars 2016, un deuxième avant le 7 mars 2018 et le troisième devait se tenir avant le 7 mars 2020. (voir note sociale « le casse-tête des entretiens professionnels »).
De plus, tous les 6 ans, un bilan des entretiens professionnels doit obligatoirement être réalisé avec le salarié. Ce bilan peut être dressé à l’issue du 3ème entretien.
Cette durée de 6 ans s’apprécie au cas par cas par référence à l’ancienneté de chaque salarié dans l’entreprise.
Ces dispositions font l’objet de l’article 1.21 –d-1 – Entretien professionnel – de la convention collective nationale des Service de l’automobile, mais attention, notre convention collective est plus favorable au salarié car elle prévoit un entretien professionnel dans l’année suivant l’embauche.
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 a sensiblement modifié le cadre du bilan à 6 ans et précise que lors des entretiens, une information doit être délivrée au salarié sur la VAE (validation des acquis de l’expérience), le CEP (conseil en évolution professionnelle), le CPF (compte personnel de formation) et les organismes pouvant délivrer des formations.
Avec la crise sanitaire, le report de l’entretien professionnel a été repoussé au 30 juin 2021. Ceux qui n’auraient pas pu tenir cette échéance, avaient jusqu’au 30 septembre 2021.
Pour qui ?
Cette obligation concerne toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, et s’adresse à tous les salariés : contrats à durée déterminée ou indéterminée, d’apprentissage, de professionnalisation, etc. Sont exclues les personnes qui ne sont pas des salariées de l’entreprise : les étudiants et stagiaires sous convention de stage, les intérimaires, les salariés mis à disposition…
L’entretien professionnel
L’entretien professionnel est le 1er entretien d’un salarié ayant 2 ans d’ancienneté, le 2ème entretien d’un salarié ayant 4 ans d’ancienneté, ou le 3ème entretien d’un salarié ayant 6 ans ou plus d’ancienneté.
ATTENTION : au regard de la convention collective des services de l’automobile, en son article Article 1.21 – Formation professionnelle – d) Situation des salariés au regard de la formation professionnelle – Entretien professionnel, il est précisé » L’entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien professionnel dans l’année suivant l’embauche, puis tous les deux ans, entendus comme 24 mois complètement ou partiellement travaillés… ».
Cet entretien doit également être proposé au salarié qui reprend son travail au terme :
- d’un congé de maternité ;
- d’un congé parental d’éducation (y compris à temps partiel) ;
- d’un congé de soutien familial ;
- d’un congé d’adoption ;
- d’un congé sabbatique ;
- d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
- d’un arrêt longue maladie ;
- d’un mandat syndical.
L’article 1.21 – d-1 – de la convention collective prévoit en outre un entretien professionnel :
1° après l’obtention de toute certification inscrite au RNCSA ;
2° préalablement à toute perspective de changement des fonctions ou de l’emploi ;
3° à la demande du salarié, dans le cas visé à l’article 1-21 a) 1 : Si pendant une période de 24 mois un salarié n’a pas bénéficié d’une action de formation au titre de la formation professionnelle continue, il peut faire une demande d’entretien professionnel en vue d’obtenir une action dans sa filière professionnelle; lorsque aucune solution n’a pu être trouvée à l’issue de cet entretien, l’employeur portera cette demande à l’ordre du jour de la réunion du comité social et économique, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l’intérêt du salarié.
4° en cas d’échec du salarié à l’examen organisé au terme d’une action de formation professionnelle ;
« L’entretien professionnel » ne doit pas être confondu avec un entretien d’évaluation du travail du salarié (non prévu par le code du travail), ni avec « l’entretien annuel individuel » imposé pour les salariés en forfait jours par l’article L 3121-46 du Code du travail.
Il faut donc respecter le terme « ENTRETIEN PROFESSIONNEL ».
Cet entretien est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle (qualification et emploi), autrement dit aux besoins et souhaits de formation et d’évolution.
Il doit comporter également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, et depuis le 1er janvier 2019, des informations concernant l’activation par le salarié de son Compte Personnel de Formation (CPF), les abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et le conseil en évolution professionnelle (CEP).
Si le salarié n’a pas mis à jour son compte CPF relatif à ses droits acquis au titre du DIF au 30 juin 2021, ses droits antérieurs seront définitivement perdus.
Invitation du salarié
Le salarié ne doit pas être « convoqué » à un entretien professionnel : il doit être « invité à bénéficier » d’un entretien professionnel. Il peut donc refuser ce bénéfice.
L’employeur fixe la date de l’entretien et invite le salarié à bénéficier de cet entretien. Mieux vaut le faire par écrit (courrier, email) permettant de justifier du respect de l’obligation légale, en cas de refus ou de report de l’entretien par le salarié.
Compte-rendu écrit : voir modèle de document
L’entretien doit faire l’objet d’un document spécifique (confidentiel), établi en double exemplaire, signé par le représentant de l’employeur et par le salarié. Un exemplaire est remis au salarié, l’autre exemplaire est conservé par l’entreprise.
Pour en savoir plus, le ministère a mis en place un questions – réponses
L’entretien d’état des lieux
Tous les six ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est dressé, pour vérifier qu’au cours des six dernières années, il a :
- au moins suivi une action de formation ;
- acquis des éléments de certification (par la formation ou la validation des acquis de l’expérience) ;
- bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle ;
L’augmentation salariale résultant d’une augmentation collective est prise en compte. L’employeur invite le salarié à en bénéficier.
Cet « entretien d’état des lieux » fait l’objet d’un compte-rendu confidentiel séparé de celui de l’entretien professionnel dont un exemplaire est remis au salarié. Il peut être fait après un entretien professionnel, ou lors d’un entretien spécifique « entretien d’état des lieux » si les 3 entretiens ont déjà eu lieu.
L’état des lieux permet de vérifier si le salarié a bénéficié d’au moins une formation dite « non obligatoire ». L’action de formation obligatoire est celle qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’un texte spécifique (une convention internationale, une loi ou un règlement).
La formation peut être réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail. Elle n’a pas de durée minimum imposée par la loi (elle peut ne durer qu’une heure). Mais elle doit répondre à un objectif inscrit dans le Plan de développement des compétences (ex Plan de formation).
Si le salarié a refusé des formations qui lui ont été proposées, cela figurera dans le compte-rendu.
Le support doit mentionner : (voir modèle)
- la ou les actions de formation réalisées (intitulé de la formation, durée de l’action, réalisation de l’action dans le cadre du plan de formation ou en utilisant les heures de CPF, bénéfices de l’action de formation pour le salarié, etc.) ;
- le cas échéant, les éléments de certification acquis (intitulé du titre, du diplôme ou de la certification, modalités de l’acquisition, durée de la validation, etc.) ;
- les éventuelles progressions dont le salarié a bénéficié (évolution dans les fonctions, progression en termes de rémunération, en application d’une augmentation décidée à titre individuel ou collectif, etc.).
Pour préparer son entretien professionnel, le salarié peut se faire accompagner par le conseil en évolution professionnel (CEP) à contacter via OPCO mobilités.
Quels bénéfices pour le salarié et l’employeur ?
- l’entretien professionnel permet au salarié non seulement de se positionner sur son emploi actuel, mais aussi de se projeter à plus long terme pour renforcer ses compétences par la formation ou la VAE par exemple. Ce sera l’occasion d’évoquer les difficultés rencontrées, ses besoins en formation, sa volonté d’évoluer professionnellement ou de se reconvertir ….
- pour l’employeur l’entretien peut lui permettre d’identifier les difficultés rencontrés par le salarié et lui proposer les formations adéquates, identifier des compétences à développer, proposer un nouveau poste, fidéliser le salarié.
Quel risque pour l’employeur si aucun entretien ?
En cas de non-respect de ses obligations, l’employeur encourt des sanctions :
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, si un salarié n’a pas, au cours des 6 années, bénéficié des entretiens prévus et d’au moins 2 des 3 actions prévues (formation non obligatoire, VAE, progression salariale ou professionnelle) d’ici le 31 décembre 2020, l’employeur devra abonder son compte personnel de formation de 3 000 euros (abondement correctif) et verser une somme d’un montant égal à la Caisse des dépôts et des consignations.
Depuis le 1er janvier 2021, cet abondement s’applique lorsque le salarié n’a pas bénéficié au cours des 6 années des entretiens prévus et d’au moins une formation non obligatoire.
En cas de non-respect de ces dispositions et si l’entreprise ne verse pas d’elle-même ces sommes, elle prend le risque, en cas de contrôle, de devoir payer en plus au Trésor public, un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, en cas de non-respect de ces règles, il n’y a pas de sanctions prévues. Mais le salarié pourrait obtenir des dommages et intérêts s’il saisit le conseil de prud’hommes.
Le fait de ne pas avoir mener un ou plusieurs entretiens, ne vous rendra pas service, dans le cas où un de vos salariés serait dans une situation « d’insuffisance professionnelle » et que vous envisagez un licenciement pour ce motif. Les tribunaux pourraient être à même de vérifier si le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel qui aurait pu permettre de détecter l’insuffisance et d’y pallier, ou au contraire de prouver qu’il y a bien insuffisance.