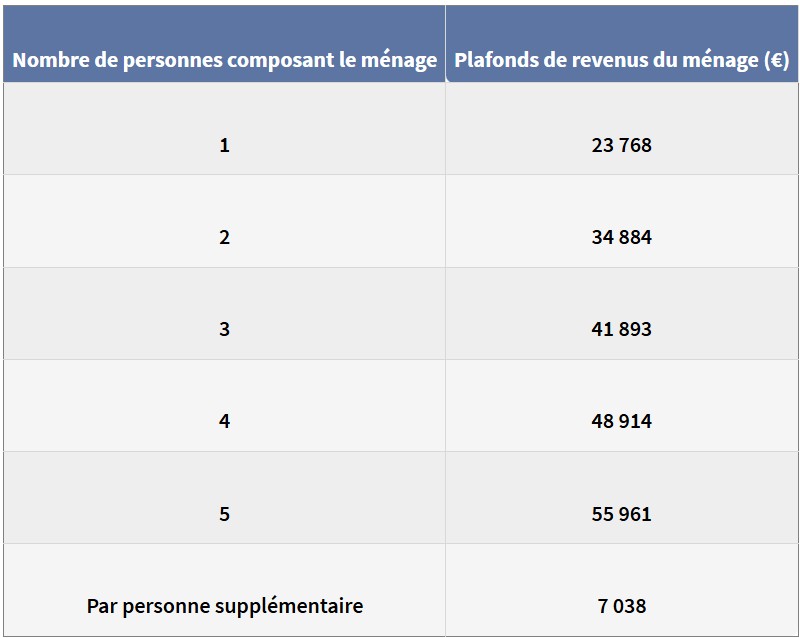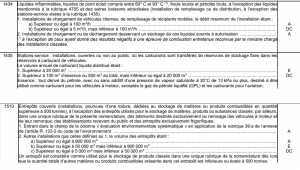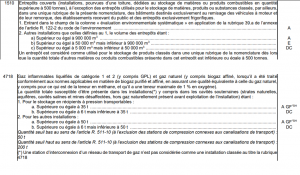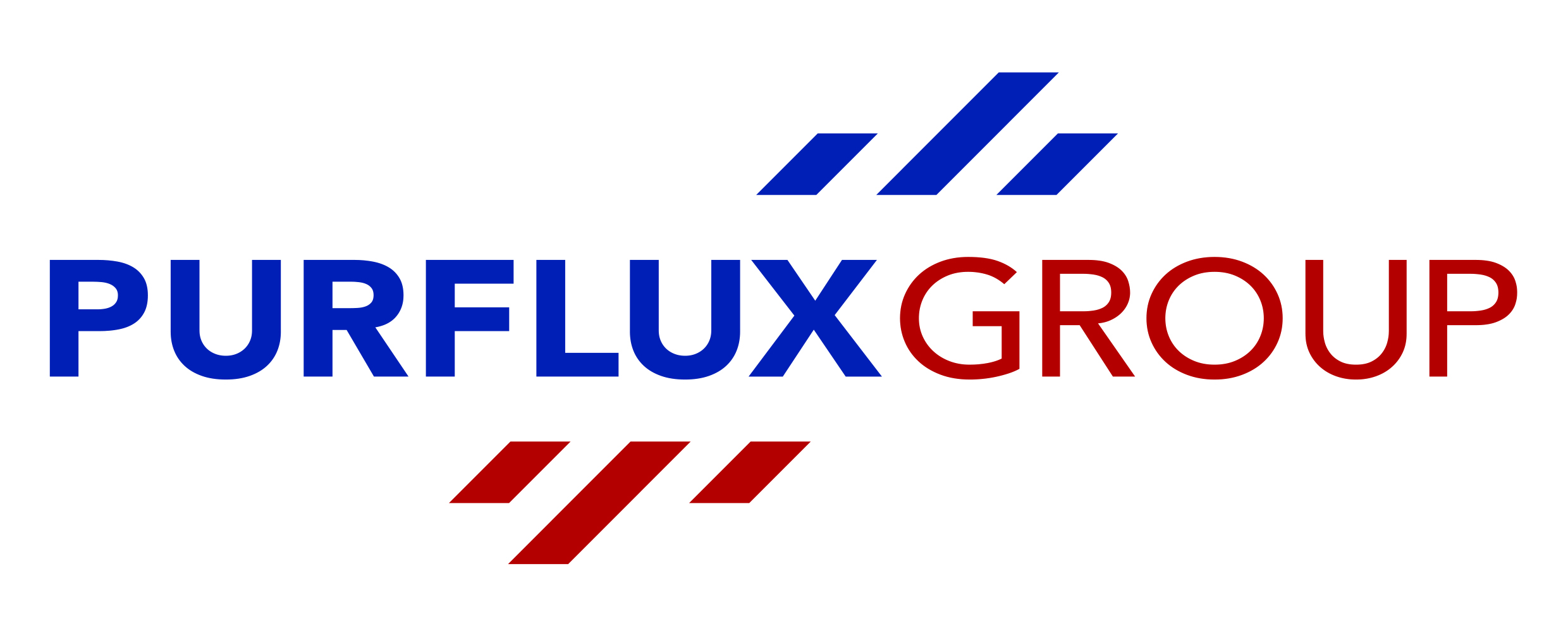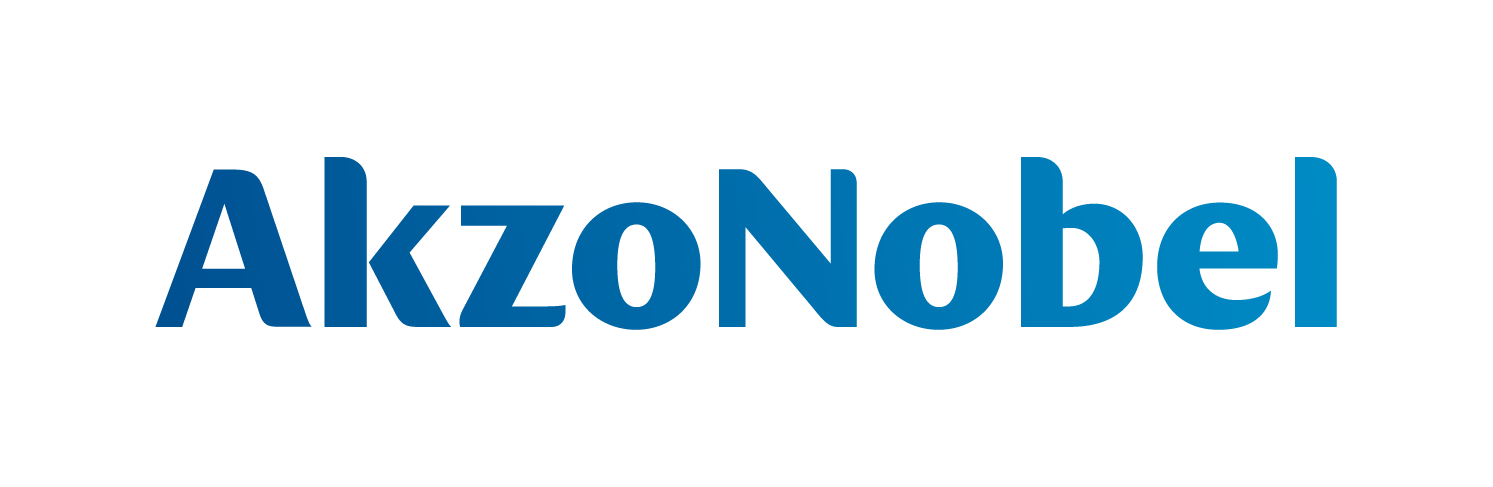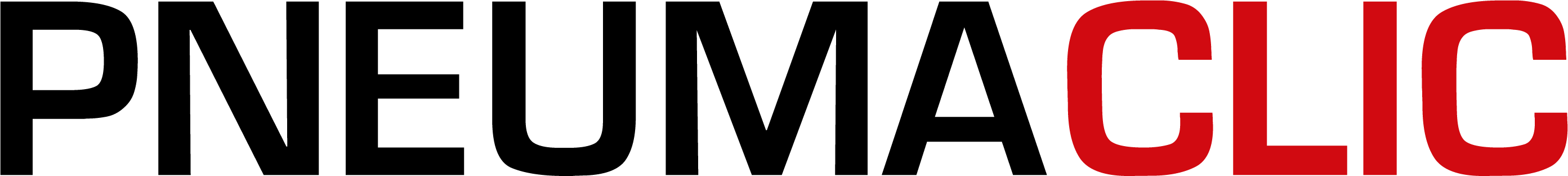Le question du renforcement des conditions d’habilitation des professionnels de l’automobile au SIV était en discussion depuis plusieurs années. C’est désormais chose faite avec la publication de l’arrêté du 1er juillet 2025 (JO du 9 juillet) modifiant les dispositions de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules.
Le renforcement des conditions d’habilitation est devenu nécessaire en raison des nombreuses fraudes à l’immatriculation qui sévissent actuellement, et dont certains professionnels de l’automobile sont eux-mêmes victimes. L’objectif de ce renforcement n’est ni de sanctionner, ni d’écarter les professionnels de l’automobile habilités mais plutôt de sécuriser ce réseau afin d’assainir la situation.
Nous vous présentons ci-dessous les conditions à respecter pour obtenir l’habilitation au SIV.
- Les professionnels actuellement signataires d’une convention d’habilitation au SIV devront se mettre en conformité dans un délai d’un an, à savoir avant le 1er août 2026, en signant un avenant avec leur préfecture de rattachement.
- Les professionnels de l’automobile déposant une demande d’habilitation se verront appliquer ces nouvelles conditions à compter du 1er août 2025.
Le ministère de l’intérieur a rassuré la FNA en lui indiquant que les préfets feront preuve de discernement concernant les professionnels déjà habilités. Nous vous conseillons cependant de faire le point au sein de votre entreprise afin de répondre à chacune des conditions exposées ci-dessous.
Qui peut être habilité au SIV ?
Le professionnel de l’automobile habilité s’entend d’une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l’aménagement, à l’importation, à la réparation, à l’achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués.
Il peut être habilité par le préfet territorialement compétent à télétransmettre des opérations directement dans le SIV.
Les prestataires de service, participant à l’activité d’immatriculation des véhicules (exemple : boutique carte grise) peuvent également bénéficier de l’habilitation dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues ci-dessous.
Les conditions préalables pour être habilité
Les conditions requises pour les entreprises individuelles demandant leur habilitation
Une personne physique, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le SIV que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Justifier de sa qualité de professionnel de l’automobile (= exercice à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l’aménagement, à l’importation, à la réparation, à l’achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués) ;
2° Ne pas faire l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s’applique à la personne physique, professionnelle de l’automobile, et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;
3° Justifier, au jour de sa demande, d’une existence légale et d’une activité professionnelle d’au moins une année ;
4° Justifier, au jour de sa demande, d’une activité stable et significative, sur une période d’une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le SIV. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;
5° Disposer d’un local dédié à son activité professionnelle.
Les conditions requises pour les personnes morales demandant leur habilitation
Une personne morale, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le SIV que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Justifier de sa qualité de professionnel de l’automobile (= exercice à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l’aménagement, à l’importation, à la réparation, à l’achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués) ;
2° Ne pas faire l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s’applique aux dirigeants, aux associés et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;
3° Justifier, au jour de sa demande, d’une existence légale et d’une activité professionnelle d’au moins une année ;
4° Justifier, au jour de sa demande, d’une activité stable et significative, sur une période d’une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le SIV. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;
5° Disposer d’un local dédié à son activité professionnelle.
Les pièces justificatives à fournir pour une demande d’habilitation
Les pièces justificatives à fournir pour les entreprises individuelles demandant leur habilitation
La personne physique, professionnelle de l’automobile, candidate à l’habilitation doit fournir les pièces justificatives suivantes à l’appui de sa demande :
– un justificatif d’identité en cours de validité et, le cas échéant, le justificatif d’identité en cours de validité de chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;
– la déclaration des bénéficiaires effectifs le cas échéant ;
– le récépissé d’inscription sur le registre des revendeurs d’objets mobiliers (livre de police), le cas échéant ;
– le registre d’objets mobiliers, le cas échéant, ou tout autre document susceptible de prouver les caractères principal et effectif de l’activité d’achat et vente de véhicules ;
– les récépissés des démarches adressées au ministre de l’intérieur par voie électronique, ou tout autre document de nature à démontrer les caractères stable et significatif de l’activité d’immatriculation ;
– le bail commercial, le titre de propriété, l’autorisation d’ouverture au public, l’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle à l’adresse personnelle d’habitation délivrée par le bailleur et, le cas échéant, la mairie, ou tout autre document de nature à prouver l’existence d’un local dédié à l’activité professionnelle.
Les pièces justificatives à fournir pour les personnes morales demandant leur habilitation
La personne morale, professionnelle de l’automobile, candidate à l’habilitation doit fournir les pièces justificatives suivantes à l’appui de sa demande :
– les justificatifs d’identité en cours de validité de chaque dirigeant, associé et préposé qui réalise les télétransmissions ;
– la déclaration des bénéficiaires effectifs, le cas échéant ;
– le récépissé d’inscription sur le registre des revendeurs d’objets mobiliers (livre de police), le cas échéant ;
– le registre d’objets mobiliers, le cas échéant, ou tout document susceptible de prouver les caractères principal et effectif de l’activité d’achat et vente de véhicules ;
– les récépissés des démarches adressées au ministre de l’intérieur par voie électronique, ou tout autre document de nature à démontrer les caractères stable et significatif de l’activité d’immatriculation ;
– le bail commercial, le titre de propriété, l’autorisation d’ouverture au public, l’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle à l’adresse personnelle d’habitation délivrée par le bailleur et, le cas échéant, la mairie, ou tout autre document de nature à prouver l’existence d’un local dédié à l’activité professionnelle.
| Le préfet peut exiger la fourniture de toute autre pièce justificative de nature à lui permettre de contrôler le respect des conditions et obligations. |
Le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et d’un pouvoir de contrôle des professionnels habilités.
Ainsi, le préfet peut procéder à la vérification de l’identité de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale, professionnelle de l’automobile, candidate à l’habilitation en sa présence et sur présentation d’un justificatif d’identité.
Lorsque le professionnel est habilité, le préfet procède aux contrôles de l’activité du professionnel habilité sur pièces, sur place et à distance via l’accès au coffre-fort numérique. Il détient un droit d’évocation de tous documents détenus par le professionnel liés à l’immatriculation des véhicules et au SIV.
Obligation du coffre-fort numérique
Le professionnel de l’automobile habilité est désormais dans l’obligation d’archiver les pièces justificatives constituant le dossier d’immatriculation sous format dématérialisé sécurisé, et dans une qualité suffisante pour assurer l’authenticité des documents. Il peut en outre conserver des archives sous format papier.
L’archivage des documents est réalisé au moyen d’un coffre-fort numérique conforme aux normes de sécurité en vigueur, souscrit par le professionnel, permettant un accès en consultation à distance par les services du ministère de l’intérieur.
Les dossiers d’immatriculation sont archivés par le professionnel de l’automobile pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle ce dernier les détruit.
La convention d’habilitation
Si l’habilitation est accordée au professionnel de l’automobile, le préfet territorialement compétent conclut une convention d’habilitation avec ce dernier. La convention précise notamment les obligations incombant au professionnel habilité et les conditions de télétransmission.
La convention d’habilitation est signée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable tacitement. Si l’habilitation est refusée, le préfet territorialement compétent notifie la décision de refus au professionnel de l’automobile.
La convention prévoit notamment les exigences et normes en matière de sécurité des systèmes d’information que sont tenus de respecter les professionnels habilités.
Le professionnel de l’automobile habilité doit veiller à l’utilisation conforme de ses modes d’accès au SIV.
Les certificats numériques (clé SIV) acquis par le professionnel de l’automobile pour télétransmettre des opérations dans le SIV ainsi que leur nombre exact sont déclarés par le professionnel à la signature de la convention. Le professionnel informe le préfet territorialement compétent, dans un délai de trois jours, de toute acquisition ou résiliation de certificats numériques tout au long de la durée de la convention.
Les profils d’accès au SIV sont attribués au professionnel de l’automobile habilité suivant la nature de l’activité professionnelle qu’il exerce et au regard des pièces justificatives fournies. L’octroi de fonctionnalités spécifiques est conditionné à certaines garanties fixées par la convention.
Le préfet détermine les profils et fonctionnalités, le cas échéant, qui peuvent être octroyés au professionnel de l’automobile.
Le retrait et la suspension de l’habilitation
Le ministre de l’intérieur ou le préfet territorialement compétent peut suspendre ou retirer l’habilitation dans les cas suivants :
– lorsque les conditions et obligations ne sont pas respectées ;
– lorsque tout changement, notamment d’adresse ou de dirigeant de l’entreprise, n’est pas signalé au préfet territorialement compétent dans un délai de quinze jours ;
– en cas de négligence ;
– en cas de démarche frauduleuse.
Le préfet territorialement compétent organise une procédure contradictoire préalable, pour mettre un terme à ces manquements.
Au terme de cette procédure contradictoire préalable, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d’un préavis de deux mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le retrait de l’habilitation.
Attention : le ministre de l’intérieur ou le préfet peut suspendre ou retirer l’habilitation, en cas d’urgence et dans un délai de quarante-huit heures suivant le constat de l’un des cas précités.
|
Les professionnels actuellement signataires d’une convention d’habilitation au SIV devront se mettre en conformité dans un délai d’un an, à savoir avant le 1er août 2026, en signant un avenant avec leur préfecture de rattachement. A l’issue de ce délai, les professionnels habilités ne respectant pas les nouvelles exigences prévues se verront retirer de plein droit leur habilitation. N’hésitez pas à solliciter (par écrit : mail ou courrier) votre préfecture de rattachement dans ce délai d’un an afin de lui demander la signature de cet avenant. |