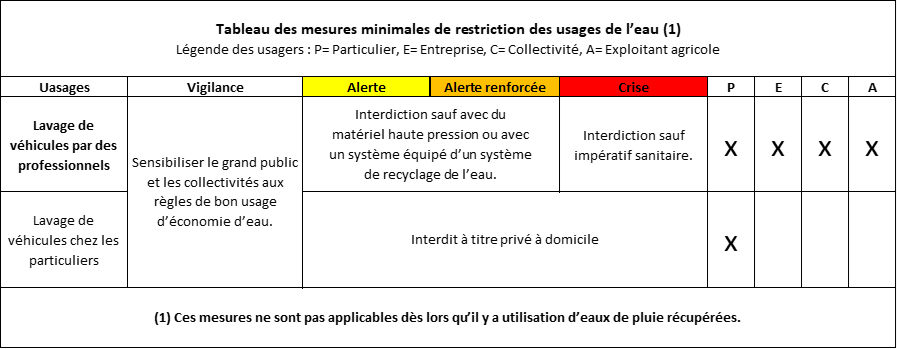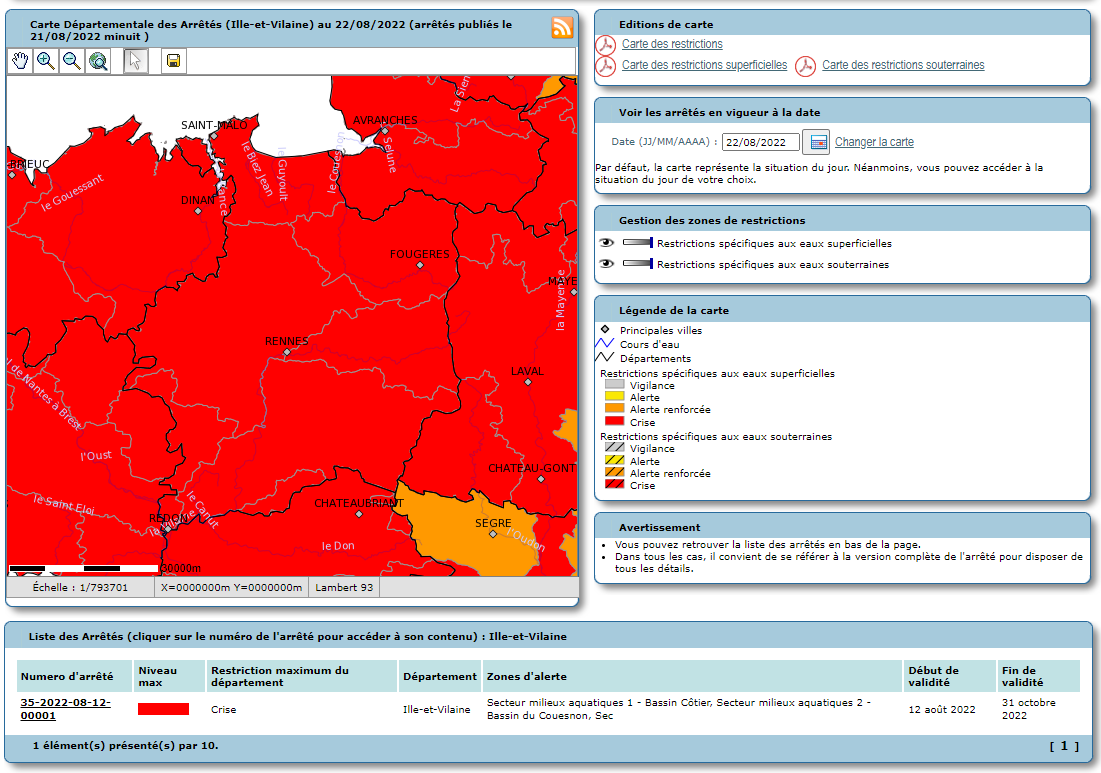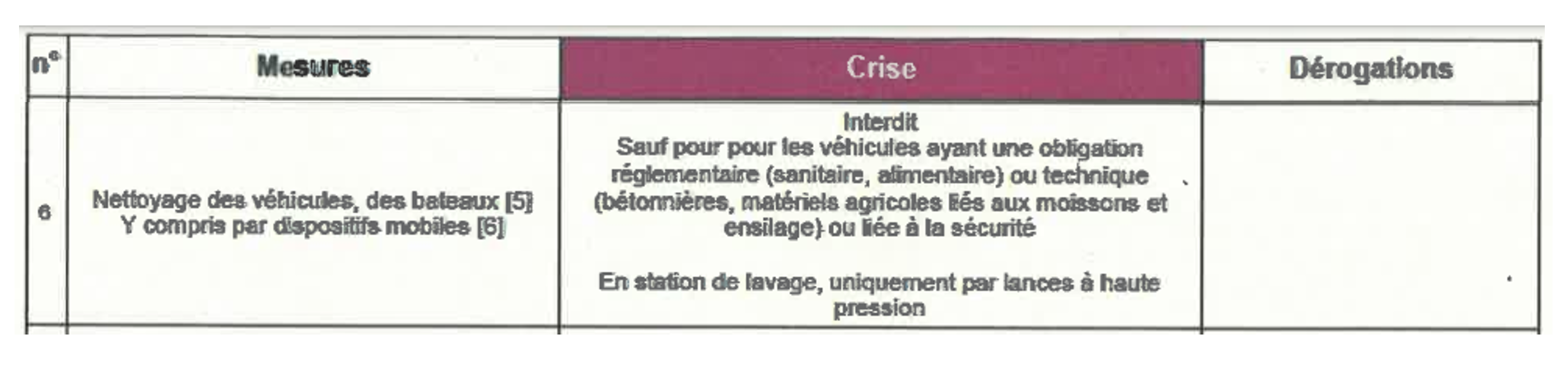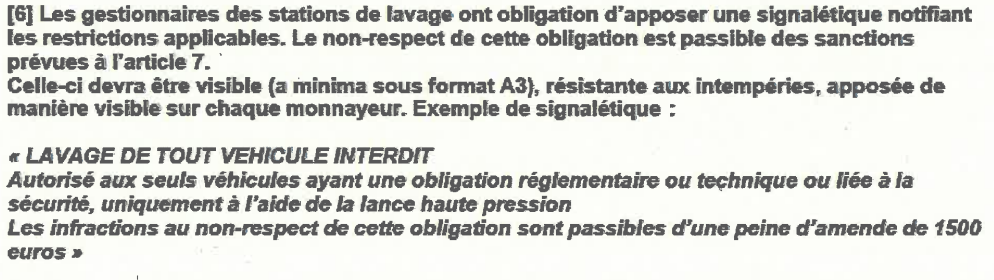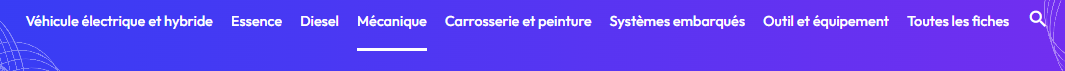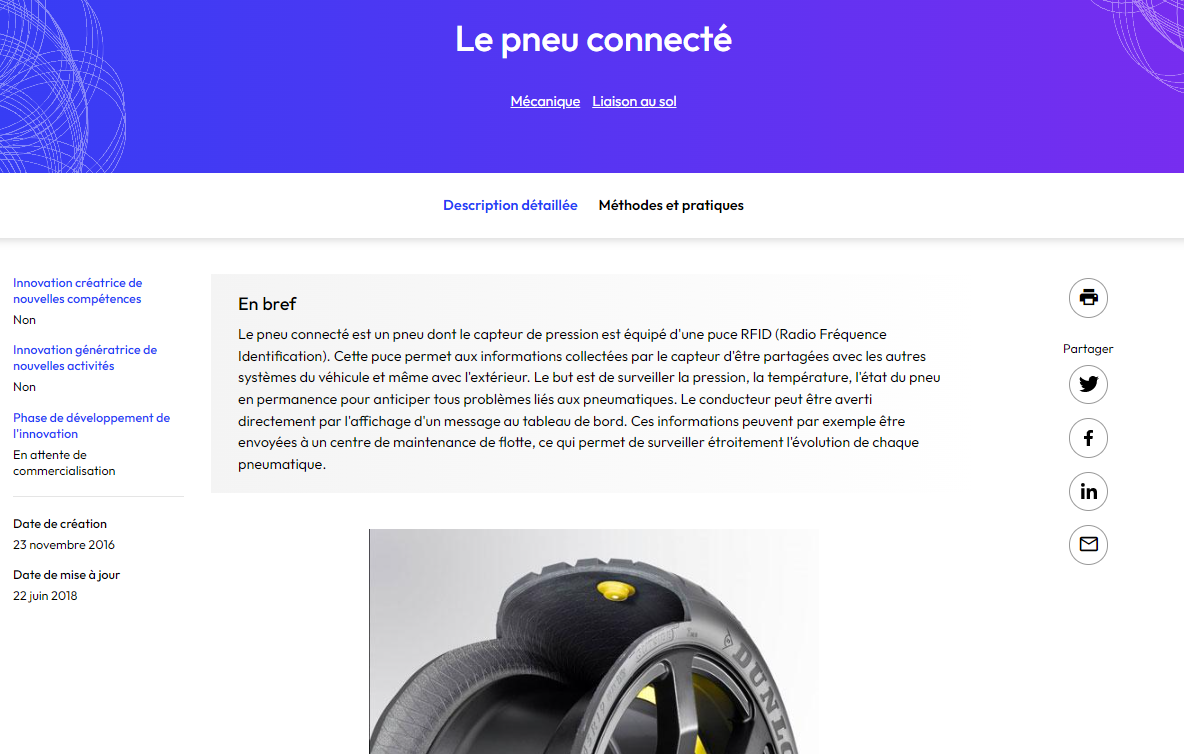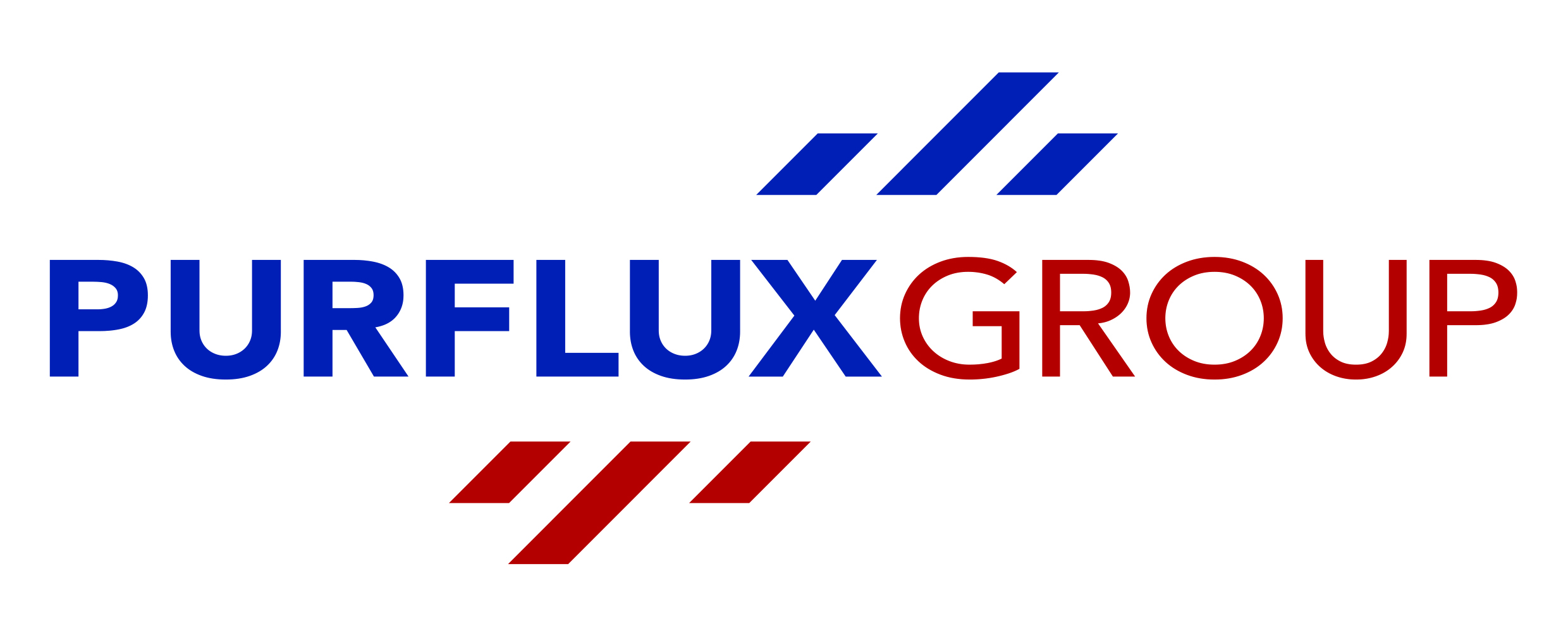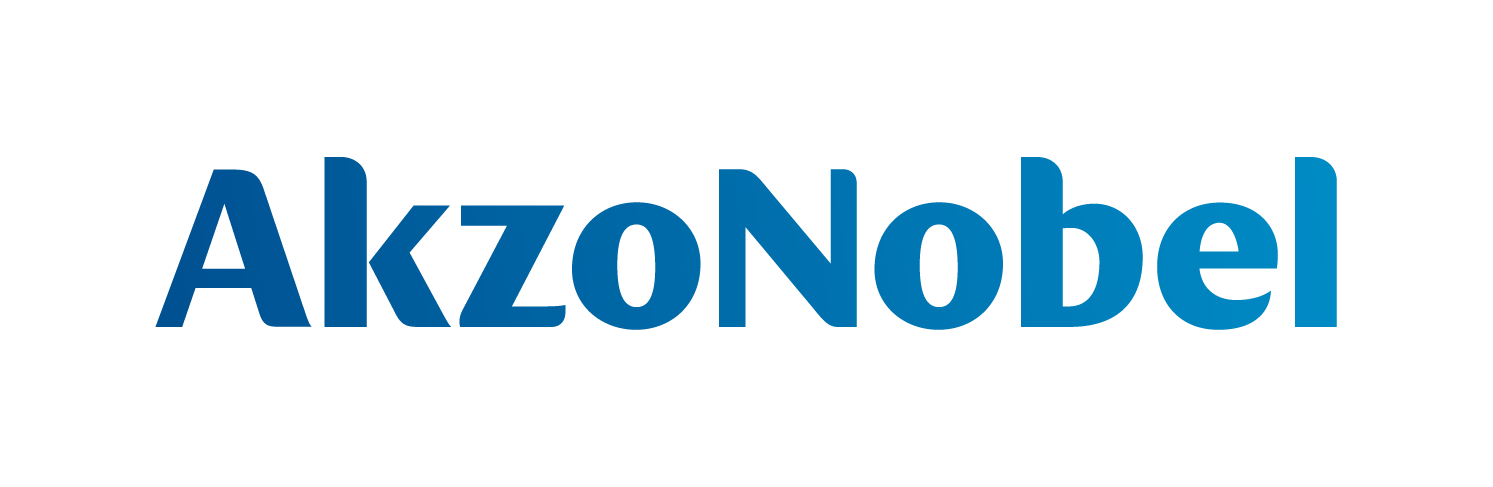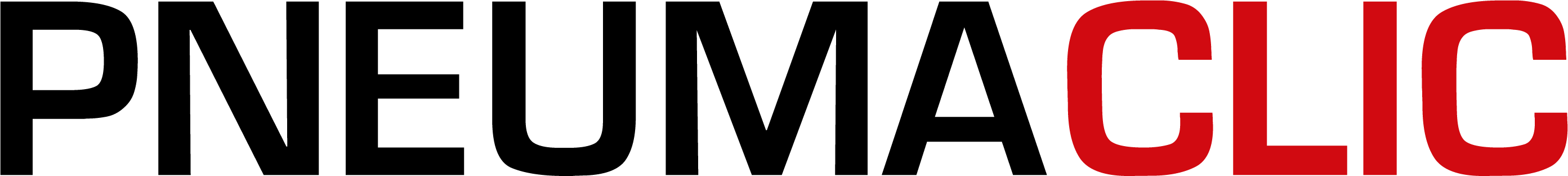Les députés et sénateurs ont examiné tout au long du mois de juillet les différentes mesures proposées par le Gouvernement dans son projet de loi pour le pouvoir d’achat. Ceux-ci ont finalement adopté deux séries de mesures au sein de la loi pour la protection du pouvoir d’achat et de la loi de finances rectificative 2022, constitutives du paquet « pouvoir d’achat ». Ces textes ont été publiés le 17 août 2022.
Voici ce que vous devez retenir concernant le carburant et les stations-service :
Prolongation de la remise carburant
Le gouvernement a voté la prolongation de la remise carburant dont le montant s’élèvera à :
- 30 centimes TTC/L (25 centimes HT) du 1er septembre au 31 octobre 2022
- 10 centimes TTC/L (8.33 centimes HT) du 1er novembre au 31 décembre 2022
Pour rappel, cette remise (instaurée par Jean CASTEX pour faire face à la hausse du prix des carburants) visible à la pompe pour l’ensemble des usagés, était de 15 centimes HT du 1er avril au 31 juillet et a été prolongée pour le mois d’août.
La FNA travaille actuellement sur le projet de décret qui devrait être publié dans les prochains jours.
Elle maintient également sa demande initiale d’instaurer une aide financière pour compenser la perte des stations services qui n’ont pas pu acheter du carburant remisé au 1er avril et qui se sont retrouvées en difficultés face aux stations à gros volumes.
► Conseils aux gérants de stations-service : Anticipez dès maintenant vos stock afin de pouvoir commander du carburant remisé à – 25 cts HT dès le 1er septembre.
Fonds de soutien pour les stations-service
Les députés et sénateurs ont voté une enveloppe de 15 millions d’euros en faveur des stations-service indépendantes. Une première victoire pour la FNA, qui se réjouit d’avoir enfin été entendue.
Ces 15 millions d’euros devraient permettre aux petites et moyennes stations-service indépendantes, essentiellement situées en zones rurales et péri-rurales de diversifier leurs offres et d’investir pour la transformation énergétique.
Forte de son expérience lors de la gestion du CPDC (Comité Professionnel de la Distribution de Carburants) qui a malheureusement pris fin en 2015, la FNA accompagnera le gouvernement dans la gestion du budget alloué aux stations-service, en fonction des investissements réalisés.